Eldorado – Laurent Gaudé
 Actes Sud – août 2006 – 238 pages
Actes Sud – août 2006 – 238 pages
Présentation de l’éditeur
A Catane, le commandant Salvatore Piracci travaille à la surveillance des frontières maritimes. Gardien de la citadelle Europe depuis vingt ans, il sillonne la mer, de la Sicile à la petite île de Lampedusa, pour intercepter les bateaux chargés d’émigrés clandestins qui ont tenté la grande aventure en sacrifiant toute leur misérable fortune… en sacrifiant parfois leur vie, car il n’est pas rare que les embarcations que la frégate du commandant accoste soient devenues des tombeaux flottants, abandonnés par les équipages qui ont promis un passage sûr et se sont sauvés à la faveur de la nuit, laissant hommes, femmes et enfants livrés à la plus abominable des dérives. Un jour, c’est justement une survivante de l’un de ces bateaux de la mort qui aborde le commandant Salvatore Piracci, et cette rencontre va bouleverser sa vie. Touché par l’histoire qu’elle lui raconte, il se laisse peu à peu gagner par le doute, par la compassion, par l’humanité… et entreprend un grand voyage.
Biographie de l'auteur
Romancier et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé a publié chez Actes Sud plusieurs pièces de théâtre et trois romans : Cris (2001), La Mort du roi Tsongor (2002, prix Goncourt des lycéens 2002, prix des Libraires 2003) et Le Soleil des Scorta (prix Populiste, prix Jean-Giono et prix Goncourt 2004).
Mon avis : (lu en octobre 2006)
Cette fois, Laurent Gaudé a choisi un sujet sensible : l'immigration clandestine. On suit l'histoire de ses africains qui tentent au péril de leurs vies de gagner l'Eldorado européen. Le voyage devient une tragédie humaine. Ce livre nous met dans la peau des migrants, mais aussi de ceux chargés de les recevoir comme le commandant Piracci (garde côte italien) qui, depuis vingt ans, sauve les hommes de la noyade pour les conduire vers les centres d'accueil d'où ils seront renvoyés vers leur pays d'origine. Mais un jour, sa rencontre avec une migrante va changer sa vision de la vie. Le style est concis, poétique, efficace. Mais mon seul petit bémol, c'est que j'ai trouvé la fin de l'histoire un peu bâclée.
Extrait : (page 61)
- Pourquoi lui ai-je donné mon arme ?
- Parce qu'elle le voulait, répondit simplement le vieux buraliste. Et comme Salvatore Piracci restait interdit, il ajouta : elle le voulait. De tout son être. Combien de fois dans ta vie, Salvatore, as-tu vraiment demandé quelque chose à quelqu'un ? Nous n'osons plus. Nous espérons. Nous rêvons que ceux qui nous entourent devinent nos désirs, que ce ne soit même pas la peine de les exprimer. Nous nous taisons. Par pudeur. Par crainte. Par habitude. Ou nous demandons mille choses que nous ne voulons pas mais qu'il nous faut, de façon urgente et vaine, pour remplir je ne sais quel vide. Combien de fois as-tu vraiment demandé à quelqu'un ce que tu voulais ?
- Je ne suis pas sûr de l'avoir jamais fait, répondit Salvatore Piracci en souriant.
- Et si tu l'avais fait, continua Angelo, crois-tu vraiment que l'on aurait pu te dire non ?
Extrait : (page 120)
- L'herbe sera grasse, dit-il, et les arbres chargés de fruits. De l'or coulera au fond des ruisseaux, et des carrières de diamants à ciel ouvert réverbéreront les rayons du soleil. Les forêts frémiront de gibier et les lacs seront poissonneux. Tout sera doux là-bas. Et la vie passera comme une caresse. L'Eldorado, commandant. Ils l'avaient au fond des yeux. Ils l'ont voulu jusqu'à ce que l'embarcation se retourne. En cela, ils ont été plus riches que vous et moi. Nous avons le fond de l'oeil sec, nous autres. Et nos vies sont lentes.
Extrait : (page 126)
Le camion roule. Je sens une force sourde qui monte en moi. Jusqu'à présent je n'avais fait que suivre mon frère, maintenant je pars pour le sauver. Je ne dormirai plus la nuit. Je me nourrirai de ver. Je serai dur à la tâche et infatigable comme une machine. On pourra m'appeler 'esclave', je n'en aurai cure. La fatigue pourra me ronger les traits, je n'en aurai cure.J'ai hâte.
Le camion roule. Nous laissons les faubourgs d'Al-Zuwarah derrière nous pour aller trouver le navire qui nous emmènera en Europe. Dès demain,j'y serai. Dès demain, alors,j'enverrai de l'argent à Jamal. Je me concentre sur cette idée. Je suis une boule dure de volonté et rien ne me fera dévier de ma route. La promiscuité des autres corps ne me gêne pas. Les visages des autres hommes ne me font plus peur. Je n'ai qu'une hâte : que le bateau quitte l'Afrique et que mes mains se mettent à travailler.


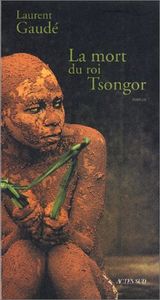




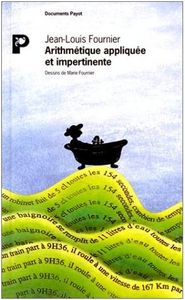






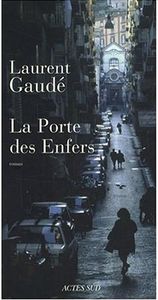
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)