Le rapport Brodeck - Philippe Claudel
Stock – août 2007 – 410 pages
Livre de Poche - avril 2009 - 374 pages
Prix Goncourt des lyçéens 2007
Mot de l'éditeur :
Le métier de Brodeck n’est pas de raconter des histoires. Son activité consiste à établir de brèves notices sur l’état de la flore, des arbres, des saisons et du gibier, de la neige et des pluies, un travail sans importance pour son administration. Brodeck ne sait même pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers fonctionnent mal, il faudra beaucoup de temps pour que la situation s’améliore.
« On ne te demande pas un roman, c’est Rudi Gott, le maréchal-ferrant du village qui a parlé, tu diras les choses, c’est tout, comme pour un de tes rapports. »
Brodeck accepte. Au moins d’essayer. Comme dans ses rapports, donc, puisqu’il ne sait pas s’exprimer autrement. Mais pour cela, prévient-il, il faut que tout le monde soit d’accord, tout le village, tous les hameaux alentour. Brodeck est consciencieux à l’extrême, il ne veut rien cacher de ce qu’il a vu, il veut retrouver la vérité qu’il ne connait pas encore. Même si elle n’est pas bonne à entendre.
« A quoi cela te servirait-il Brodeck ? s’insurge le maire du village. N’as-tu pas eu ton lot de morts à la guerre ? Qu’est-ce qui ressemble plus à un mort qu’un autre mort, tu peux me le dire ? Tu dois consigner les événements, ne rien oublier, mais tu ne dois pas non plus ajouter de détails inutiles. Souviens-toi que tu seras lu par des gens qui occupent des postes très importants à la capitale. Oui, tu seras lu même si je sens que tu en doutes... » Brodeck a écouté la mise en garde du maire.
Ne pas s’éloigner du chemin, ne pas chercher ce qui n’existe pas ou ce qui n’existe plus. Pourtant, Brodeck fera exactement le contraire.
Auteur : Né à Dombasle-sur-Meurthe le 02 février 1962 et considéré comme l'un des meilleurs auteurs contemporains, Philippe Claudel est à la fois enseignant, scénariste et écrivain. Maître de conférences à l'université de Nancy, il enseigne à l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel.
Depuis son premier roman, 'Meuse l'oubli', paru en 1999, l'écrivain lorrain enchaîne les succès littéraires. 'J' abandonne', en 2000, lui a permis de recevoir le prix France Télévisions. Il enchaîne avec 'Le Bruit des trousseaux', tiré de son expérience de professeur de français dans les prisons, puis 'Les Petites Mécaniques' sont récompensées par la bourse Goncourt de la nouvelle en 2003. Avec ses 'Ames grises', œuvre unanimement reconnue par la critique, Philippe Claudel est lauréat du prix Renaudot en 2003 et parrain du 16e Festival du premier roman la même année. Il publie encore 'Trois petites histoires de jouets' et 'La Petite Fille de monsieur Linh' en 2005. Ponctuel, il revient l'année suivante avec 'Le Monde sans les enfants', dans lequel il aborde les tabous de notre société, dont la maltraitance, la guerre ou la mort. En 2007 sort 'Le Rapport de Brodeck', dans la lignée de son maître Jean Giono. En 2008, il réalise son premier film 'Il y a longtemps que je t'aime' avec Kristin Scott Thomas et Elsa Zylberstein. Par ses romans, l'auteur nous emmène dans un univers imperceptible néanmoins empreint de réalité. Philippe Claudel a sa place parmi les grands romanciers du XXIe siècle.
Mon avis : (lu en décembre 2007)
Ce livre est à la fois magnifique, bouleversant mais aussi terrifiant.
Brodeck doit faire un rapport sur un fait qui a eu lieu dans son village. Ce fait est le meurtre collectif de "l'Anderer" (l'étanger). Brodeck ne va pas faire un simple rapport, il veut également rapporter toute la genèse de l'évènement. Il veut laisser un témoignage le plus complet possible et ainsi participer à la mémoire collective. Brodeck décrit tout simplement, sans émettre aucun jugement.
Ce conte est intemporel. On n'a aucune notion précise du lieu et de la période où se situe cette histoire. Tout ce que l'on sait, on le devine en lisant entre les lignes, en interprétant chaque détail. C'est untrès grand roman universel qui parle des hommes, de leurs peurs et de leur lâcheté, de la mémoire et de l'oubli aussi, et comment les hommes choisissent d'accommoder leur vie pour continuer à vivre.
L'écriture de ce livre est très belle, fluide et d'une simplicité apparente, ce livre est à la fois un leçon de français, d'humanité et d'histoire.
Extrait : "Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout le monde le sache. Moi je n’ai rien fait, et lorsque j’ai su ce qui venait de se passer, j’aurais aimé ne jamais en parler, ligoter ma mémoire, la tenir bien serrée dans ses liens de façon à ce qu’elle demeure tranquille comme une fouine dans une nasse de fer. Mais les autres m’ont forcé : « Toi, tu sais écrire, m’ont-ils dit, tu as fait des études. » J’ai répondu que c’étaient de toutes petites études, des études même pas terminées d’ailleurs, et qui ne m’ont pas laissé un grand souvenir. Ils n’ont rien voulu savoir : « Tu sais écrire, tu sais les mots, et comment on les utilise, et comment aussi ils peuvent dire les choses. Ça suffira. Nous on ne sait pas faire cela. On s’embrouillerait, mais toi, tu diras, et alors ils te croiront. Et en plus, tu as la machine. »
La machine, elle est très vieille. Plusieurs de ses touches sont cassées. Je n’ai rien pour la réparer. Elle est capricieuse. Elle est éreintée. Il lui arrive de se bloquer sans m’avertir comme si elle se cabrait. Mais cela, je ne l’ai pas dit car je n’avais pas envie de finir comme l’Anderer.
Ne me demandez pas son nom, on ne l’a jamais su. Très vite les gens l’ont appelé avec des expressions inventées de toutes pièces dans le dialecte et que je traduis : Vollaugä – Yeux pleins – en raison de son regard qui lui sortait un peu du visage ; De Murmelnër – Le Murmurant – car il parlait très peu et toujours d’une petite voix qu’on aurait dit un souffle ; Mondlich – Lunaire – à cause de son air d’être chez nous tout en n’y étant pas ; Gekamdörhin – celui qui est venu de là-bas.
Mais pour moi, il a toujours été De Anderer – l’Autre –, peut-être parce qu’en plus d’arriver de nulle part, il était différent, et cela, je connaissais bien : parfois même, je dois l’avouer, j’avais l’impression que lui, c’était un peu moi. Son véritable nom, aucun d’entre nous ne le lui a jamais demandé, à part le maire une fois peut-être, mais il n’a pas, je crois, obtenu de réponse. Maintenant, on ne saura plus. C’est trop tard et c’est sans doute mieux ainsi. La vérité, ça peut couper les mains et laisser des entailles à ne plus pouvoir vivre avec, et la plupart d’entre nous, ce qu’on veut, c’est vivre. Le moins douloureusement possible. C’est humain. Je suis certain que vous seriez comme nous si vous aviez connu la guerre, ce qu’elle a fait ici, et surtout ce qui a suivi la guerre, ces semaines et ces quelques mois, notamment les derniers, durant lesquels cet homme est arrivé dans notre village, et s’y est installé, comme ça, d’un coup.
Pourquoi avoir choisi notre village ? Il y en a tellement des villages sur les contreforts de la montagne, posés entre les forêts comme des œufs dans des nids, et beaucoup qui ressemblent au nôtre. Pourquoi avoir choisi justement le nôtre, qui est si loin de tout, qui est perdu ?
Tout ce que je raconte, le moment où ils ont dit qu’ils voulaient que ce soit moi, ça s’est passé à l’auberge Schloss, il y a environ trois mois. Juste après… juste après le… je ne sais pas comment dire, disons l’événement, ou le drame, ou l’incident. À moins que je dise l’Ereigniës. Ereigniës, c’est un mot curieux, plein de brumes, fantomatique, et qui signifie à peu près, « la chose qui s’est passée ».
C’est peut-être mieux de dire cela avec un terme pris dans le dialecte, qui est une langue sans en être une, mais qui épouse si parfaitement les peaux, les souffles et les âmes de ceux qui habitent ici. L’Ereigniës, pour qualifier l’inqualifiable. Oui, je dirai l’Ereigniës.
Cela venait donc de se produire. À l’exception de deux ou trois vieillards demeurés près de leurs fourneaux, et sans doute du curé Peiper qui devait cuver sa prune quelque part dans sa petite église aux murs larges comme l’envergure d’un aigle, tous les hommes étaient là, dans l’auberge qui est comme une grosse caverne un peu sombre, étouffée de fumée de tabac et de fumée d’âtre, hébétés, assommés par ce qui venait de se passer, et dans le même temps, comment dire, soulagés, parce qu’il fallait bien que ça se termine, d’une façon ou d’une autre. On n’en pouvait plus, vous savez.
Chacun était comme replié dans son silence, même si à presque quarante personnes dans l’auberge, on se trouvait serrés comme des joncs de saule dans un fagot, à s’étrangler, à sentir les odeurs des autres, leurs haleines, leurs pieds, la poisse âcre de leur sueur, de leurs vêtements humides, de vieille laine et de drap, frottés de poussière, de forêt, de fumier, de paille, de vin et de bière, surtout de vin. Ce n’est pas que les uns et les autres étaient saouls, non, ce serait trop facile l’excuse de l’ivresse. On gommerait d’un coup toute atrocité. Trop simple. Beaucoup trop simple. Je vais essayer de ne pas réduire ce qui est très difficile, et complexe. Je vais essayer. Je ne promets pas que j’y arriverai. Que l’on me comprenne bien, je le redis, moi, j’aurais pu me taire, mais ils m’ont demandé de raconter, et quand ils m’ont demandé cela, la plupart avaient les poings fermés ou les mains dans les poches, que j’imaginais serrées autour des manches de leurs couteaux, ceux-là mêmes qui venaient juste de… Il ne faut pas que j’aille trop vite, mais c’est difficile parce que je sens maintenant dans mon dos des choses, des mouvements, des bruits, des regards. Depuis quelques jours, je me demande si je ne me change pas peu à peu en gibier, avec toute une battue à mes trousses et des chiens qui reniflent. Je me sens épié, traqué, surveillé, comme si toujours désormais il y avait quelqu’un derrière mon épaule pour saisir le moindre de mes gestes et lire dans mon cerveau.
J’y reviendrai à ce à quoi les couteaux ont servi. Forcément j’y reviendrai. Ce que je voulais dire, c’est que refuser ce qu’on vous demande, dans cette humeur si particulière où tout le monde a encore la tête pleine de sauvagerie et d’idées de sang, ce n’est pas possible, et c’est même très dangereux. Donc, j’ai accepté, bien malgré moi. Je me suis simplement trouvé dans l’auberge, au mauvais moment, quelques minutes après l’Ereigniës, à ce moment de stupeur qui est un moment de bascule et d’indécision, où l’on se raccrochera au premier qui ouvrira la porte, soit pour en faire un sauveur, soit pour le tailler en pièces.
Challenge Prix Goncourt des Lycéens 2007
2007
Challenge Goncourt des Lycéens
chez Enna
Déjà lu du même auteur :
 Les âmes grises
Les âmes grises 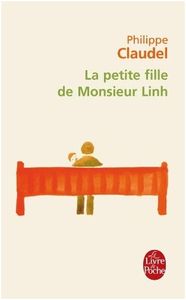 La petite fille de Monsieur Linh
La petite fille de Monsieur Linh
 Le monde sans les enfants
Le monde sans les enfants



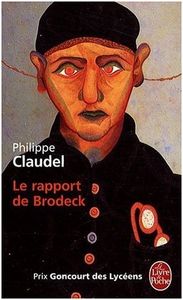


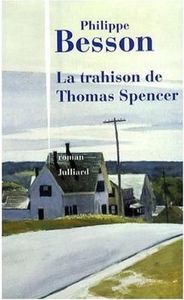
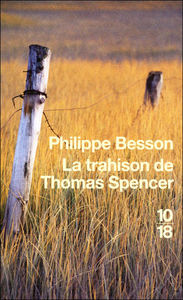
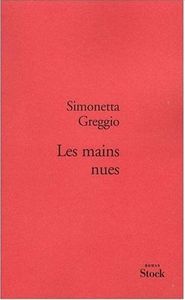





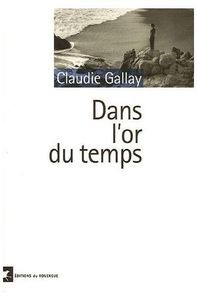
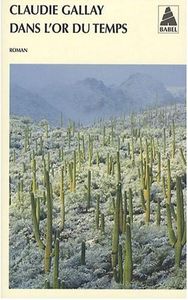
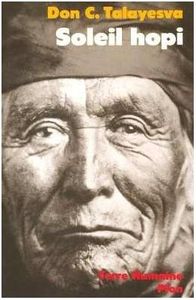

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)