Une forêt d'arbres creux - Antoine Choplin
Lu dans le cadre des Matchs de la Rentrée Littéraire 2015 PriceMinister

 La fosse aux ours - août 2015 - 120 pages
La fosse aux ours - août 2015 - 120 pages
Quatrième de couverture :
TEREZIN, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, décembre 1941.
Bedrich arrive dans la ville-ghetto avec femme et enfant. Il intègre le bureau des dessins.
Il faut essayer de trouver chaque matin un peu de satisfaction en attrapant un crayon, jouir de la lumière sur sa table à dessin, pour enfin s'échapper du dortoir étouffant, oublier la faim, la fatigue et l'angoisse.
Chaque jour se succèdent commandes obligatoires, plans, aménagements de bâtiments. Chaque nuit, le groupe se retrouve, crayon en main, mais en cachette cette fois. Il s'agit de représenter la réalité de Terezin sans consigne d'aucune sorte.
Et alors surgissent sur les feuilles visages hallucinés, caricatures. Tout est capté et mémorisé la nuit puis dissimulé précieusement derrière cette latte de bois du bureau des dessins.
Auteur : Né en 1962, Antoine Choplin vit près de Grenoble, où il partage son temps entre l’écriture et l’action culturelle. Il est directeur de « Scènes obliques », dont la vocation est d’organiser des spectacles vivants dans les lieux inattendus, des sites de montagne. Il est aussi l’animateur depuis 1996 du Festival de l’Arpenteur (Isère), qui chaque mois de juillet programme des rencontres inhabituelles entre des créateurs (notamment des écrivains) et le public. Il s’est fait connaître en 2003 lors de la publication de son roman, Radeau, (2003), qui a connu un vrai succès populaire (Prix des librairies « Initiales », Prix du Conseil Général du Rhône). Parmi ses derniers titres : Léger Fracas du Monde (2005), L’impasse (2006), Cairns (2007), et de Apnées (2009), Cour Nord (2010), Le héron de Guernica (2011), La nuit tombée (2012), Les gouffres (2014).
Mon avis : (lu en novembre 2015)
Ce livre est un vrai coup de poing et coup de coeur.
Dans ce livre, Antoine Choplin nous raconte une histoire vraie, celle de Bedrich Fritta, un artiste tchèque déporté au camp de Terezin avec sa femme et son fils âgé de 1 an. Bedrich a été affecté au bureau des dessins techniques, il y dessine et supervise les plans d'aménagement du camp, en particulier, il va devoir avec son équipe dessiner les plans des futurs crématoriums.
La nuit, en secret, avec quelques uns de ses compagnons, ils dessinent leur quotidien, la réalité du camp. Comme un acte de résistance, ils veulent témoigner et durant quelques heures dessiner "librement".
Un travers un récit cours, juste, sobre et avec une écriture poétique, l'auteur dessine le ghetto de Terezin avec son l'atmosphère pesante, ses horreurs, la violence, la peur de partir dans ces trains vers la mort, la fatigue des corps amaigris mais aussi ses petits gestes d'humanité, ses lueurs d'espoir, la passion de l'art qui aide à survivre, la résistance...
Merci PriceMinister pour ce partenariat et cette découverte poignante.
Après cette lecture touchante et forte, je me suis renseignée sur Bedrich Fritta (1906 - mort à Auschwitz en novembre 1944), voici ci-dessous quelques uns de ses dessins :
Dessin "officiel" destiné à la propagande
Dessins non officiels
Livre d'image réalisé en 1943 et 1944 pour les 3 ans de Tommy, le 22 janvier 1944
Extrait : (début du livre)
Quand il regarde les deux arbres de la place, il pense à tous les arbres du monde.
Il songe à leur constance, qu’ils soient d’ici ou de là-bas, du dehors ou du dedans. Il se dit : vois comme ils traversent les jours sombres avec cette élégance inaltérée, ce semblable ressort vital. Ceux bordant la route qui relie la gare au ghetto, et qui s’inclinent à peine dans la nudité ventée des espaces. Ceux des forêts au loin, chacun comme une obole au paysage, et dont la cohorte se perd au flanc des montagnes de Bohême. Ceux aussi des jardins de l’enfance et que colorent les chants d’oiseaux. Ceux des collines froides, des bords de mer, ceux qui font de l’ombre aux promeneurs de l’été.
Ces deux-là sont peut-être des ormes. Des ormes diffus, à en juger par l’opulence décousue de la ramure. Même au seuil de l’hiver, la seule densité des branches réussit à foncer le sol d’un gris plus net. Voilà ce que Bedrich observe un long moment, le jour même de son arrivée à Terezin. Les deux ormes, appelons-les ainsi, de tailles sensiblement égales, jeunes encore sans doute, distants de quelques mètres à peine et confondant ainsi leurs cimes. Par contraste, la clarté laiteuse du jour perçant la ramure au cœur rend à chaque branche sa forme singulière. On voit ainsi combien la silhouette rondouillarde et équilibrée de l’arbre résulte de l’agrégat d’élancements brisés, de lignes rompues et poursuivant autrement leur course, de désordres. Dans ce chaos que ne tempère que cette tension partagée vers le haut, l’œil a tôt fait d’imaginer des corps décharnés, souffrants, empruntant à une gestuelle de flamme ou de danseuse andalouse, implorant grâce ou criant au visage de leur bourreau la formule d’un ultime sortilège, résistant un instant encore à l’appel du gouffre que l’on croirait s’ouvrant à la base du tronc.
Juste derrière les deux ormes passe la clôture de fils de fer barbelés, quatre ou cinq lignes noires et parallèles rythmées par les poteaux équidistants. Drôle de portée avec ses barres de mesure, vide de toute mélodie, et contre laquelle, à bien y regarder, semble se disloquer la promesse des choses. Car à l’œil englobant de Bedrich, les deux arbres naguère palpitants et qui le renvoyaient à la grande fratrie des arbres du monde, lui apparaissent maintenant, par le seul fait de ces barbelés, comme un leurre. Au mieux, ils s’évanouissent en tant qu’arbres pour n’être plus que créatures incertaines, soumises à plus fort qu’elles-mêmes. Pour peu, ils ne seraient bientôt plus qu’une illusion de la perception, jetés en irréalité par le trait de la clôture.
Voilà peut-être pour ce qui est de ce regard du premier jour porté par Bedrich sur les deux ormes de la place de Terezin. S’y entrelacent, en lisière de cette désolation, l’élan et la contrainte, la vérité et l’illusion, le vivant et le mort. À eux seuls, les barbelés ne disent rien, pas plus que les arbres ; ce sont les deux ensemble qui témoignent de l’impensable.
Il repense aux forêts aperçues depuis le train et à cette étrange sérénité que ces paysages lui ont procurée malgré tout. Les forêts portent les espoirs, il se dit. Elles ne trompent pas. On n’a jamais rapporté le cas d’une forêt d’arbres creux, n’est-ce pas ?
Déjà lu du même auteur :











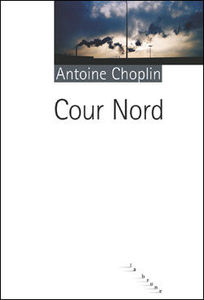
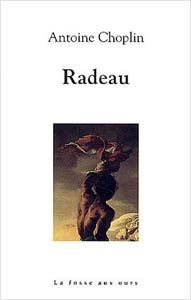


 Gallimard Jeunesse - mars 2006 - 304 pages
Gallimard Jeunesse - mars 2006 - 304 pages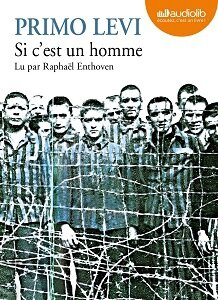
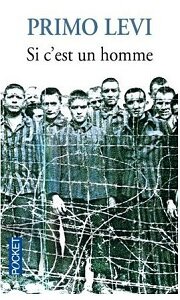

 Grasset - février 2015 - 112 pages
Grasset - février 2015 - 112 pages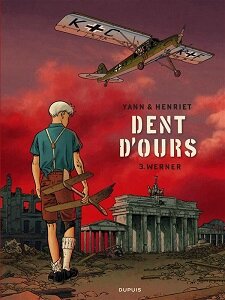 Dupuis - mai 2015 - 48 pages
Dupuis - mai 2015 - 48 pages





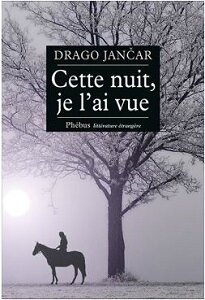 Phébus - janvier 2014 - 240 pages
Phébus - janvier 2014 - 240 pages
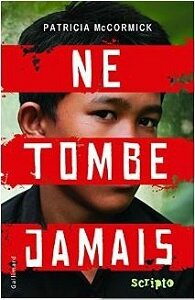 Gallimard Jeunesse - octobre 2014 - 240 pages
Gallimard Jeunesse - octobre 2014 - 240 pages

 Liana Levi - septembre 2014 - 224 pages
Liana Levi - septembre 2014 - 224 pages

 Gallimard - août 2014 - 224 pages
Gallimard - août 2014 - 224 pages

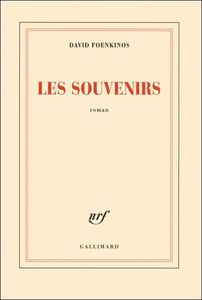

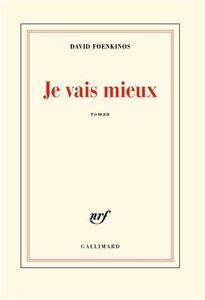
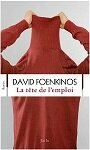

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)