 Gallimard – août 2009 - 247 pages
Gallimard – août 2009 - 247 pages
Présentation de l'éditeur :
En septembre 1944, Claire, ambulancière à la Croix-Rouge française, se trouve à Béziers avec sa section, alors que dans quelques mois elle suivra les armées alliées dans un Berlin en ruine. Elle a vingt-sept ans, c'est une très jolie jeune femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui en fait compliment, elle feint de l'ignorer. Elle souhaite n'exister que par son travail depuis son entrée à la Croix-Rouge, un an et demi auparavant. Son courage moral et physique, son ardeur font l'admiration de ses chefs. Ses compagnes, parfois issues de milieux sociaux différents du sien, ont oublié qu'elle est la fille d'un écrivain célèbre, François Mauriac, et la considèrent comme l'une d'entre elles, rien de plus. Au volant de son ambulance, quand elle transporte des blessés vers des hôpitaux surchargés, elle se sent vivre pour la première fois de sa jeune vie. Mais à travers la guerre, sans même le savoir, c'est l'amour que Claire cherche. Elle va le trouver à Berlin.
Auteur : Née en 1947, Anne Wiazemsky est la petite-fille de l'écrivain François Mauriac par sa mère Claire Mauriac. Elle est issue de la famille princière russe des Wiazemsky qui émigra en France après la révolution de 1917. Ses romans sont souvent influencés par l'histoire de sa famille. Anne Wiazemsky a également été actrice de cinéma. Sa carrière cinématographique a commencé en 1966 avec Au hasard Balthazar de Robert Bresson. On l'a aussi vue dans un rôle secondaire dans Rendez-vous d'André Téchiné en 1985. Elle a été mariée à Jean-Luc Godard de 1967 à 1979. Son frère, Pierre Wiazemsky, est un dessinateur humoristique sous le pseudonyme de Wiaz. Elle a adapté, avec Jacques Fieschi en 1997, Souvenirs avec piscine de Terence McNally, au Théâtre de l'Atelier à Paris.
Mon avis : (lu en décembre 2009)
Livre lu dans le cadre du challenge « Les coups de cœurs de la blogosphère », proposition de Clarabel
A partir du journal de sa mère, Anne Wiazemsky raconte l'amour naissant entre Claire Mauriac, fille de François Mauriac, et Yvan Wiazemsky, prince russe en exil. Nous sommes en 1945 dans Berlin en ruine, elle est ambulancière de la Croix-Rouge, il travaille pour un organisme des personnes déplacés du côté des alliées français.
Une belle histoire d'amour romanesque entre Claire et Wia, si différents mais comme on dit souvent « les contraires s'attirent et se complètent ». Le style est simple et fluide, le livre se lit vraiment facilement. Cela n'a pas été le coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment de lecture.
Extrait : (début du livre)
En septembre 1944, Claire, ambulancière à la Croix-Rouge française, se trouve encore à Béziers avec sa section. Elle a vingt-sept ans, c’est une très jolie jeune femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui en fait compliment, elle feint de l’ignorer. Elle n’a pas le temps de se contempler dans un miroir, ou alors fugitivement et toujours avec méfiance. Elle souhaite n’exister que par son travail depuis son entrée à la Croix-Rouge, un an et demi auparavant. Son courage moral et physique, son ardeur font l’admiration de ses chefs. Ses compagnes, parfois issues de milieux sociaux différents du sien, ont oublié qu’elle est la fille d’un écrivain célèbre, François Mauriac, et la considèrent comme l’une d’entre elles, rien de plus. Cela la rend heureuse. Elle aime ce qu’elle fait, la nécessité de vivre au jour le jour. Au volant de son ambulance, quand elle transporte des blessés vers des hôpitaux surchargés, elle se sent vivre, pour la première fois de sa jeune vie. Une vie sans passé, sans futur. Une vie au présent.
De sa chambre, elle regarde les toits de Béziers, la lumière dorée de la fin d’après-midi sur les tuiles. Des cloches sonnent. Sur la grande table qui lui sert de bureau, son précieux poste de T.S.F. et un bouquet de roses de jardin. À côté du vase, le cahier où elle relate quand elle peut le récit de ses journées : son journal. Autour, de nombreuses photos de ses parents, de ses frères et de sa sœur avec son bébé. Une autre, un peu à l’écart, représente un jeune homme en uniforme de soldat qui se force à sourire. Parfois, elle le contemple attendrie, amoureuse, mais maintenant, de plus en plus souvent, elle l’évite.
Ce jour-là, elle est juste attentive à ce qu’elle éprouve, un bien-être physique dû à la douceur de l’air et à un copieux repas constitué de tomates, d’œufs et de prunes trouvées dans une ferme abandonnée. Bientôt il y aura d’autres repas, bientôt elle cessera d’avoir faim. Malgré les combats qui continuent, la guerre n’est-elle pas presque finie ?
Une question alors s’impose : doit-elle rejoindre sa famille comme celle-ci le lui demande ou bien lui désobéir et suivre les armées ? La plupart de ses compagnes ont déjà fait un choix dans un sens ou dans l’autre.
Claire allume une cigarette. Inspirer la fumée, la rejeter par les narines est un plaisir dont elle ne se lasse pas. Même aux pires moments, fumer une cigarette, n’importe laquelle, l’aide à affronter le quotidien, à trouver en elle le détachement nécessaire. Un jeune lieutenant dont elle vient de faire la connaissance lui a offert toute une cartouche qu’il tient de l’armée américaine. En échange, elle doit lui faire visiter la région. Mais ils n’ont pas pris de rendez-vous, ce soldat peut être appelé à rejoindre le combat dans les jours qui viennent.
Par la fenêtre, elle regarde à nouveau les toits de Béziers. Cette ville, elle l’a aimée tout de suite et de devoir bientôt la quitter lui cause un réel chagrin. Pour aller où, ensuite ? Voilà que se repose la question à laquelle elle ne sait pas répondre.
Elle prend son cahier, s’allonge sur le lit et commence à le feuilleter comme si revoir son passé pouvait l’aider à décider de l’avenir. Elle passe très vite sur les pages concernant ses débuts à Caen puis s’attarde sur celles où elle parle de Patrice, prisonnier en Allemagne, avec qui elle correspond depuis le début de la guerre. « Mon fiancé, prononce-t-elle à mi-voix, mon fiancé... » Elle lève les yeux vers son portrait, près du vase de fleurs et le contemple avec attention. Il lui semble qu’elle ne se souvient plus aussi exactement de sa façon de se mouvoir, du timbre de sa voix.
À la date du 19 décembre 1943, lors d’un bref passage à Paris, elle a noté :
« Journée tout entière passée chez les parents de Patrice alors que je n’y étais venue que pour le déjeuner. C’est extraordinaire comme j’aime cette famille. J’ai vraiment l’impression d’être des leurs. Ses frères lui ressemblent beaucoup. Nous avons naturellement parlé de Patrice. Comme ils l’aiment et comme leur amour déborde sur moi. À leurs yeux, je suis celle que Patrice aime et je suis sacrée. En plus ils me trouvent très jolie.
Comme j’ai changé depuis l’année dernière ! Il y a un an, j’étais très malheureuse. Patrice n’était rien ou presque rien pour moi alors que maintenant il a pris une place qui grandit tous les jours davantage. Je pensais à lui avec ennui et j’avais presque peur de le voir revenir. Maintenant je compte les jours, je voudrais le voir, le toucher, lui parler, le remercier de tant m’aimer, de m’avoir appris à l’aimer, à l’attendre avec tant de joie et d’impatience.
Il y a un an, j’échouais à l’examen d’entrée à la Croix-Rouge. J’étais triste car je doutais de moi. Aujourd’hui, je sais que je suis capable. Ainsi, en cette fin d’année, je suis contente du chemin parcouru. Il me semble que Caen m’a fait un bien immense. Je suis moins égoïste et surtout je sais mieux apprécier le vrai bonheur. Je suis moins blasée. Je m’aime moins pour moi que pour Patrice. Je l’attends. Je prends un immense plaisir à imaginer notre appartement et ma vie à ses côtés. »
Sur les pages suivantes, Claire a minutieusement recopié les lettres qu’elle a envoyées à Patrice. Elle y relate des fragments de sa vie quotidienne mais se plaît surtout à rêver leur vie future dans un monde pacifié. Ce sentimentalisme, l’affirmation chaque fois répétée de son amour brusquement l’excèdent. « Quels enfantillages ! » pense-t-elle. Et aussitôt après : « Comme je me suis engagée ! » Elle en oublie que les lettres répondent à celles de Patrice, rangées dans sa valise et qu’elle relit rarement. « Pas le temps », dit-elle à voix haute comme si on lui en demandait la raison.
Elle ne lui a pas écrit depuis plusieurs jours et un soupçon de remords lui gâche la fin de sa cigarette. Vite, elle saute ces fâcheuses pages et allume une nouvelle cigarette au mégot de la précédente. Elle préfère revenir à des récits plus flatteurs qui, pense-t-elle, reflètent davantage la jeune femme qu’elle est devenue grâce à la guerre. Comme souvent, c’est une lettre qu’elle a recopiée avant de la faire transmettre par une de ses compagnes en permission. Celle-ci est adressée à sa famille, 38 avenue Théophile-Gautier, Paris XVIe.
« 21 août 1944 Mes adorables petits parents, je commence juste à réaliser que je suis dans un pays libre et que je peux écrire ce que je veux. Je pense terriblement à vous. Avant-hier soir, lorsque les postes de la T.S.F. criaient la libération de Paris, j’avais envie de pleurer tant j’étais triste de ne pas y être. À ce moment-là, j’aurais donné tout ce que j’ai vécu pendant ces quelques mois à la C.R.F. pour ces quelques heures à Paris. Vous devez avoir vu des choses formidables et j’ai presque honte de vous raconter le peu de choses que j’ai fait.
Pendant des jours et des jours, les convois allemands sont passés à Béziers. Nous, nous continuions nos missions sur des routes encombrées. Assise sur l’aile de la voiture, j’interrogeais le ciel. Plusieurs fois nous avons été prises dans d’énormes convois. Il nous était impossible d’en sortir, sauf quand les avions étaient au-dessus de nous, car la colonne s’arrêtait au bord de la route.
Les Alliés ont souvent mitraillé, mais jamais au-dessus de nous. On comprenait ce qui se passait à la figure des Allemands et à leurs voitures en feu.
Dimanche dernier, mitraillage de la ville. De 5 à 9 heures du soir, les tanks ont traversé la ville en mitraillant : 15 morts, 50 blessés. Imaginez votre petite Claire avec sa copine Martine et un agent mettant une demi-heure pour arriver jusqu’à mon ambulance. Le plus dangereux était la traversée des grandes avenues. On faisait un pas et on se collait contre le mur à cause d’une rafale de mitrailleuse. Nous avons fini par marcher lentement au milieu de la rue en montrant nos écussons et en levant les bras. Plusieurs fois, des fusils qui nous visaient se sont baissés. Pendant quatre heures nous avons parcouru les rues de Béziers pour relever les blessés. Les balles sifflaient partout, c’était formidable. Les Allemands n’ont jamais tiré directement sur nous. Je me suis mise à un moment entre deux tanks et un soldat allemand m’a fait signe de mettre un casque. Je n’ai pas eu peur et si ce n’était les morts et les blessés, j’aurais été folle de joie. Sans Martine et moi, un homme serait mort d’hémorragie. Il le sait et, chaque fois que nous allons à l’hôpital, il nous remercie. Cela fait plaisir et console de bien des choses.
J’ai passé les deux jours suivants de morgue en morgue. J’ai vu d’horribles blessures, une toute jeune fille morte que sa mère ne voulait pas laisser partir. Un jeune F.F.I. avec la bouche pleine de vers, etc., etc. J’ai été chercher dix cercueils pour dix morts.
Et puis les F.F.I. sont arrivés. Pas très beaux, pas beaucoup d’enthousiasme. Pendant tout un jour, ils ont tiré des toits et des rues sur des miliciens plus ou moins imaginaires. Pendant ce temps, je transportais les blessés d’un petit bombardement aérien. Les avions passaient au-dessus de nous et mitraillaient partout. Je n’ai pas eu le temps de penser que je pouvais mourir.
Hier, nous avons été appelés d’urgence pour aller chercher des blessés du maquis à Saint-Pons. J’étais d’autant plus contente que l’on disait que l’on s’y battait encore. On arriva dans un pays tout à fait calme après plusieurs jours de guerre. Les Allemands avaient complètement pillé la ville et allaient tout brûler, quand ils s’aperçurent qu’ils avaient une trentaine de blessés chez eux. Nous avons commencé à leur administrer les premiers soins, ils virent qu’ils allaient être bien soignés et ils nous dirent : “Nous ferons notre devoir comme vous faites le vôtre.” Et ils partirent. Les blessés du maquis avaient déjà été évacués et ce furent ces grands blessés allemands que nous ramenâmes à Béziers. Je suis restée une heure avec eux à l’hôpital. Ils souffraient tellement que j’en avais mal au cœur. J’aurais voulu avoir de la haine, je n’avais qu’une immense pitié et j’aurais voulu pouvoir les soulager. L’un d’eux, un pauvre gosse de dix-huit ans, avait une péritonite. Il était perdu et le médecin n’a pas voulu l’opérer. Sa main brûlante s’agrippait à la mienne et il me regardait avec des yeux tellement suppliants que je me suis mise à pleurer. Je pensais à tous ces hommes qui comme lui mouraient loin de leur famille. Je ne suis pas faite pour être infirmière, je serais trop malheureuse.
17 heures. Là, je viens d’aller chercher un homme qui est mort devant moi suite au mitraillage de dimanche. Je n’aime pas les morts mais j’aime encore moins voir sangloter les familles.
Il fait lourd, la ville est pleine de F.F.I., d’étoiles et de drapeaux. On espère voir arriver très bientôt les Américains au port de Sète. Figurez-vous que c’est à Sète, Agde, etc., qu’ils devaient débarquer. Ils n’ont demandé les plans de la Côte d’Azur que dix jours seulement avant le débarquement. ».
Lu dans le cadre du challenge  proposition de Clarabel
proposition de Clarabel











 Albin Michel – août 2010 – 272 pages
Albin Michel – août 2010 – 272 pages 
 Robert Laffont - mars 2010 – 454 pages
Robert Laffont - mars 2010 – 454 pages
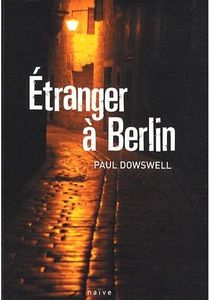 Naïve – août 2009 - 429 pages
Naïve – août 2009 - 429 pages

 Gallimard – août 2009 - 247 pages
Gallimard – août 2009 - 247 pages
 Gallimard – septembre 2009 - 186 pages
Gallimard – septembre 2009 - 186 pages


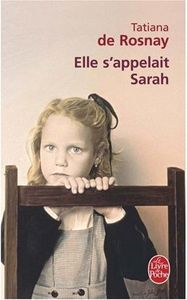
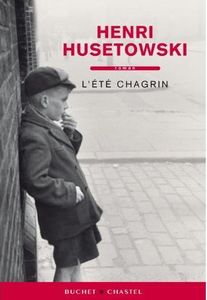 Buchet-Chastel – août 2009 – 254 pages
Buchet-Chastel – août 2009 – 254 pages/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)