Présent ? - Jeanne Benameur
Livre lu dans le cadre du  - (8/26)
- (8/26)


Edition Denoël – août 2006 – 209 page
Folio – mai 2008 – 221 pages
Présentation de l'éditeur :
Elle aurait voulu être une bête, au moins ça aurait été clair. Elle est juste professeur de la vie et de la terre, mais il n'y a plus de vie il n y a plus de terre sous ses pieds quand son amant part. Alors au collège, elle n y va pas. Qu'est-ce qu'elle enseignerait, hein ? Son corps enseignant, il est ici. Son intelligence, sa patience, son savoir, tout pourrit sans caresse. Elle se racornit comme les feuilles de certaines plantes quand elles manquent d'eau. Elle peut juste attendre qu'il revienne ou qu'elle reparte le voir. Toute la vie suspendue dans l'intervalle. Sans son corps, elle ne peut pas enseigner C'est comme ça. Elle n'a de tête que si tout le corps vit. Et elle a beau essayer de penser autrement, elle n y arrive pas. Elle pense par la peau. Son corps la mène dans la vie et elle découvre un gouffre. Le corps peut manquer à l'appel. D'une écriture incisive et empathique, Jeanne Benameur brosse le portrait de tous les acteurs d'un collège de banlieue avant les émeutes, questionnant leur présence vive. Avec émotion, elle débusque les symboliques occultées du monde scolaire et les drames intimes de chacun: une brèche s'ouvre pour une pédagogie à rebours de tous les tabous.
Auteur : Jeanne Benameur a été professeur dans les établissements dits difficiles jusqu'en 2001 et se consacre désormais à un enseignement nomade, ponctuel. Elle a récemment publié chez Denoël Les Reliques.
Mon avis : (lu en janvier 2010)
Ironie de la vie, c'est le livre que j'étais en train de lire lors de la réunion parents-professeurs pour la classe de 3ème d'un de mes fils. Ce livre m’a vraiment beaucoup plu, il nous montre la vie d’un collège un jour de conseil de classe et d’orientation d’une classe de 3ème. C’est le jour où se joue l’avenir des élèves de la classe. On découvre la Principale, les différents enseignants, le conseiller d’orientation, les parents, le personnel de service, le «factotum» qui détient les clés, la documentaliste et bien sûr les élèves. Tous ces personnages sont plein d'humanité et ils sont très attachants.
Le prof de français profite des récréations pour se plonger dans un livre pour fuir le monde. «Lire, c’est rêver. Lire, c’est laisser des images se former à partir des mots choisis par les auteurs.» La jeune prof de SVT ne supporte plus d’aller au collège, elle n’arrive pas à tenir ses élèves et elle a perdue confiance en elle. Madison est une élève qui se trouve nulle en classe car ses notes sont médiocres, elle est discrète, presque invisible, mais elle a un don pour le dessin. D. est un élève bagarreur, qui va découvrir l’atelier d’écriture de la documentaliste et reprendre confiance en lui. La documentaliste donne au CDI un aspect de bien-être avec bouquets de fleurs, elle propose aux élèves un atelier d'écriture, elle initie à la lecture les élèves mais aussi le personnel du collège...
Un livre plutôt optimiste qui fait réfléchir sur le collège et l’avenir de nos enfants, il se lit très facilement. A découvrir sans tarder !
Extrait : (début du livre)
Il y a toujours trop de monde dans les couloirs.
Couloirs. Couloir du latin colare : couler, s’écouler. Dans les couloirs, les corps devraient s’écouler. Comme de l’eau. C’est l’étymologie.
On voudrait bien.
Glisser son corps au milieu des autres, fluide. De face, impossible. Il faut biaiser. En avant ! les épaules à l’égyptienne. Ça passe, un peu. Et puis tôt ou tard, la masse fait pression plus fort. Même de biais, on n’arrive plus. On a du mal à respirer. C’est la dynamique du trop.
Dans les couloirs, on est réduit.
C’est peut-être pour ça que les enfants se poussent. Les enfants, leur dynamique à eux est verticale. De la plante des pieds à la tête, ils se dressent, cherchent à voir au-dessus de la tête des autres, plus loin. Ils résistent. Peu importe le nombre. Les épaules en avant. Cohue, cris. C’est joyeux ou ça pleurniche, coude dans une côte, pied écrasé. Qui a commencé ?
Les profs n’aiment pas être pris là-dedans. Les profs ont déjà eu le corps resserré dans les couloirs du métro. Ils ont déjà dû faire paquet avec les autres, cartable pendue au bout du bras, toujours trop lourd. Impossible de jeter un coup d’œil sur la montre : le poignet ne peut plus se frayer de chemin. Ils ont poussé aussi, comme les gamins, contents de se trouver une place assise. Mais les épaules sont lasses.
Au collège, ils attendent que le flot soit passé en buvant un petit café avec les collègues. Reprendre force. Certains, plus sûrs, se lancent, d’autorité occupent un bord du couloir. Les élèves se plaquent un peu plus contre le mur d’en face. Ceux qui ont quitté le havre de la salle des profs dans la bousculade taillent alors un passage, pour un seul corps. Un plus timide peut emboîter le pas à son collègue. Si c’est une femme, c’est galant. Le temps d’un couloir on ouvre la voie, épaules élargies, on est un chevalier.
Les couloirs sont froids, immenses quand ils sont vides. Rien n’est parfait.
L’élève en retard est seul. Toujours.
La principale du collège aussi qui va constater les dégâts faits par un coup de pied dans une porte.
Ce serait bien de pouvoir être dans un couloir, juste à deux, coude à coude, avec seulement les murs pour border la conversation.
On pourrait marcher.
On pourrait apprendre, en marchant, dans le mouvement du corps. Il y a des idées parfois comme ça qui traversent la tête.
Mais dans le collège, les couloirs sont faits pour être bondés, puis vidés.
Livre lu dans le cadre du  - (8/26)
- (8/26)
Déjà lu du même auteur :
 Les demeurées
Les demeurées  Les mains libres
Les mains libres





 Les Editions de Minuit - janvier 2006 – 123 pages
Les Editions de Minuit - janvier 2006 – 123 pages
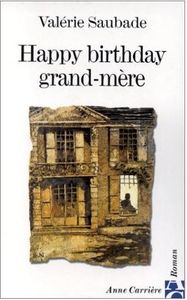
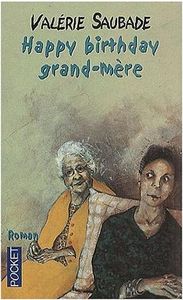
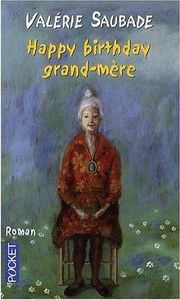





 Jean-Claude Lattès – août 2009 – 299 pages
Jean-Claude Lattès – août 2009 – 299 pages
 Éditions Viviane Hamy – août 2009 – 285 pages
Éditions Viviane Hamy – août 2009 – 285 pages





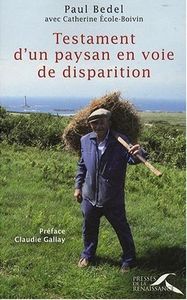
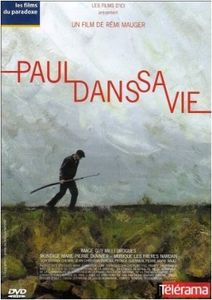



/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)