Zola Jackson – Gilles Leroy
 Mercure de France – janvier 2010 – 139 pages
Mercure de France – janvier 2010 – 139 pages
Présentation de l'éditeur :
Août 2005, delta du Mississippi : l'ouragan Katrina s'abat sur La Nouvelle-Orléans. Les digues cèdent sur le lac Pontchartrain et les quartiers modestes sont engloutis. La catastrophe touche de plein fouet la communauté noire. Tandis que ses voisins attendent des secours qui mettront des jours à arriver, l'institutrice Zola Jackson s'organise chez elle pour sa survie. L'eau continue de monter, inexorablement. Du ciel, les hélicoptères des télévisions filment la mort en direct. Réfugiée dans le grenier avec sa chienne Lady, Zola n'a peut-être pas dit son dernier mot. Sous la plume de Gilles Leroy, Zola Jackson, femme de trempe et mère émouvante, rejoint le cercle des grandes héroïnes romanesques.
Auteur : Né en 1958, après un parcours classique de littérature qui l'amène sur les bancs d'hypokhâgne et khâgne au lycée Lakanal, Gilles Leroy passe une DEUG de lettres et arts en 1977, suivi d'une licence puis d'une maîtrise de lettres modernes en 1979. Il achève son cursus universitaire par un mémoire sur le poète Henri Michaux. Il exerce ensuite divers métiers, avant de devenir journaliste de presse écrite et audiovisuelle durant quelques années. En 1996, il quitte Paris pour vivre à la campagne, dans le Perche, où il se consacre à l'écriture. Il profite de son temps libre pour voyager, étudier seul les littératures américaine et japonaise et s'adonner à tout ce qui le passionne. Gilles Leroy publie son premier roman, 'Habibi', en 1987. Ce dernier sera suivi par une dizaine d'autres, dont 'L' Amant russe' en 2002, 'Grandir' en 2004, 'Champsecret' en 2005 ou encore 'Alabama Song' en 2007. Gilles Leroy a su imposer à travers quelques ouvrages sa plume légère et sensible.
Mon avis : (lu en mars 2010)
La veille de la tempête Xynthia, je terminais le livre Une catastrophe naturelle – Margriet de Moor, qui raconte une histoire construite autour d'une terrible tempête fin janvier 1953 qui avait fait céder de nombreuses digues et rayé de la carte le Sud-Ouest des Pays-Bas...
Ce livre Zola Jackson est dans ma PAL depuis quelque temps et il est lui aussi malheureusement d'une grande actualité puisqu'il évoque l'ouragan Katrina qui s'est abattue sur la Nouvelle-Orléans en août 2005 et faisant céder des digues, le Mississippi inondera les quartiers les plus pauvres.
Zola Jackson est une femme noire, institutrice à la retraite, elle vit seule avec sa chienne Lady. Elle habite le quartier de Gentilly, un des plus populaires de la Nouvelle-Orléans. A l'annonce de la tempête Katrina, elle organise sa survie chez elle, ce n'est pas la première tempête qu'elle affronte, Betsy en 1965, Ivan en 2004. Elle est toute seule dans sa vie, son fils, Caryl est mort depuis dix ans alors où fuir ? Par flash-backs, elle évoque également sa vie passée.
A travers ce récit entre présent et passé, le lecteur assiste heure par heure à l'horreur de la tragédie et découvre une femme, un mère courageuse et émouvante. Zola Jackson va subir les vents de l'ouragan, puis les pluies diluviennes, ensuite la montée des eaux avec les digues cédant les une après les autres et Zola obligée de se réfugier jusque sous le toit de sa maison, elle va devoir supporter la canicule de l'après tempête. Elle refusera de quitter sa maison sans Lady...
Gilles Leroy dénonce également l'incompétence des autorités : peu de sauveteurs sont envoyés sur place, ils mettront trop de temps à arriver. «Mais non, l'armée ne viendra pas. L'armée est retenue loin, très loin de nous, dans les déserts d'Orient. Quelle ironie.»
Beaucoup de moyens ont été mis en œuvre par les médias pour faire du sensationnel avec la catastrophe plutôt que pour aider au secours des victimes. « Dans le ciel, ils sont arrivés par dizaines et ils ont tourné, de midi à minuit, des hélicoptères venus non pas nous sauver mais plutôt assister à notre fin : il faut croire que n'importe quelle chaîne de télévision, fût-elle à l'autre bout du pays, était assez organisée et riche pour voler jusqu'à nous et réussir là où le gouvernement de la première puissance au monde échouait. »
On assiste à une mise en scène de sauvetage par un acteur célèbre... «L'acteur a franchi le perron de la maison Grant, pour en ressortir quelques instants plus tard une fillette dans les bras. (…) Sur leurs scooters, les cadreurs se rapprochaient, les photographes aussi, au ralenti et en sourdine jusqu'à former un demi-cercle : j'attendais les alligators et, ma foi, ils étaient là. Tout le monde doit manger. Ceux-là ne mangent que la chair riche et célèbre.»
Un livre très fort, une écriture juste et pour moi beaucoup d'émotions.
Extrait : (page 27)
Quand j'ai rouvert les yeux, c'était déjà le soir. Du ciel livide, tout soleil effacé. La lumière avait cette matité lugubre que l'on connaît bien chez nous et j'ai compris que ça n'allait pas trop.
J' avais la langue pâteuse de trop de bière, de bourbon et de somnifères, les joues humides, les yeux chassieux. Comme si j'avais pleuré dans mon sommeil.
Sur l'oreiller voisin, la chienne roulée en boule gémit et frissonne, les yeux révulsés sous la paupière gauche ourlée de noir. Elle aussi doit faire un rêve. Un rêve mauvais, un rêve cruel, comme celui qui pendant quelques minutes ou quelques heures a fait revivre Caryl sous mes paupières noyées - et il faut en passer par ce temps suspendu, cette hésitation sur l'heure et le jour, la mémoire et l'espoir, cet insidieux et lent retour du réel, qui en moins d'une seconde fera chavirer le jour nouveau en nouvel enfer, fera succéder aux larmes de joie un torrent de douleur.
Car il est mort. Caryl est mort. Il sourit sur la table de chevet, mais en fait il est mort.
Extrait : (page 73)
Les hélicoptères des garde-côtes ont fait un tour d'observation. Ils jetaient çà et là des bouées, des gilets à ceux qui leur tendaient les bras depuis la rue, l'eau jusqu'aux épaules. Ils ont même repêché Samuel, le vieux chanteur obèse. Samuel aussi a un chien, un corniaud blanc et noir, malin comme tout, qui l'accompagnait par les rues, portait dans sa gueule le vieux chapeau où les touristes charmés tant par la bête frétillante que par la belle voix de Sam glissaient des pièces, des billets d'un dollar pour les plus généreux. Comme il était trop volumineux pour tenir dans une nacelle, ils lui ont jeté un harnais orange et hop ! Le gros Sam soulevé des deux bras s'est envolé dans le ciel bleu sans un chant pour le Seigneur. Qu'est devenu le chien de Sam ?
A la santé de Sam, j'ai pris le bourbon dans le chevet et je lui ai fait un sort. (...)
Qu' est devenu le corniaud blanc et noir ? Qu'est devenu le chien de Samuel ? Il deviendra fou, le gros Sam, sans son partenaire pour faire la manche. Car c'est un duo qu'ils forment, un numéro d'amour, et il n'est pas certain que la belle voix veloutée du chanteur (étonnante voix flûtée, gracile, presque chevrotante, hébergée par ce corps outré tel un rossignol dans le ventre d'un éléphant), pas sûr qu'elle fût vraiment ce que préféraient les touristes dans le spectacle.
En complément, le site de l'auteur.








 Albin Michel – août 2009 – 757 pages
Albin Michel – août 2009 – 757 pages


 Éditions de l'Olivier – août 2009 – 292 pages
Éditions de l'Olivier – août 2009 – 292 pages


 Liana Levi – janvier 2010 – 143 pages
Liana Levi – janvier 2010 – 143 pages









 Les Editions de Minuit - janvier 2006 – 123 pages
Les Editions de Minuit - janvier 2006 – 123 pages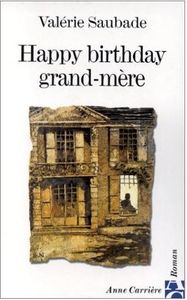
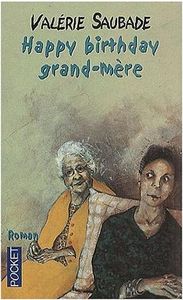
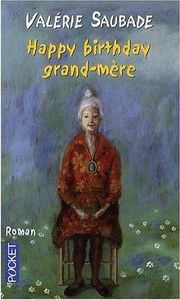

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)