

Edition Héloïse d'Ormesson – mars 2006 – 205 pages
10x18 – juillet 2008 – 222 pages
traduit du néerlandais par Daniel Cunin
Présentation de l'éditeur
Une petite villa de location sur l'île de Vlieland, quelque part sur la côte frisonne. Le temps d'un été, des vacanciers se succèdent à Duinroos, la maison des dunes. Familles à la dérive, couples en crise, chacun y trouve refuge pour se découvrir ou accepter l'inéluctable. Les histoires changent, le lieu demeure. Quelques chaises, des assiettes, un lit pour faire le point sur sa vie. Semaine après semaine, c'est la maison elle-même qui prend âme. Comme un trait d'union entre les parenthèses. Et dans le Livre d'or posé sur la commode, si les battements de cœur sont différents, le tempo est unique. Tout a commencé en arrivant ici, par le bateau du soir... Après Les Invités de l'île, une nouvelle échappée dans l'univers subtil de Vonne van der Meer.
Biographie de l'auteur
Vonne van der Meer est née en 1952 aux Pays-Bas. Avec sa trilogie de Duinroos dont "La Maison dans les dunes (ou les invités de l'île)", "Le Bateau du soir", elle rencontre un succès phénoménal dans toute l'Europe.
Mon avis : (juillet 2009)
Une ballade au bord de la mer, aux saveurs simples. C'est la suite du premier roman de Vonne van der Meer intitulé "La Maison dans les dunes ou les invités de l'île". On y retrouve quelques personnages croisés dans le premier livre : l'homme dont la femme était très malade, et qui était venue seule dans la maison de Vlieland quelques mois plus tôt. Il y a aussi Martine qui était venue l'année passée avec un jeune fille enceinte. Cette année, elle est accompagnée de sa mère et attend l'arrivée de son nouveau fiancé. Les vacanciers se succèdent avec leurs soucis, leurs angoisses... La femme de ménage est toujours présente de façon discrète. La mer, les dunes et la maison font partie prenante du roman. J'ai pris un égal plaisir à retourner sur l'île de Vlieland et j'ai passé un très agréable moment de lecture !
J'ai appris également que le troisième volet " Le Voyage vers l’enfant " sera publié fin août.
Extrait : (début du livre)
Je m’en suis sortie, une fois de plus. Tout est propre, tout marche. Tapis battus, rideaux repassés et accrochés ; ampoule neuve à la lampe au-dessus de la table ronde. La maison sent encore un peu l’alcool à brûler. Juste ce qu’il faut, non pas comme une dame qui se serait trop parfumée.
Reste mon petit tour d’inspection. Une dernière fois, je passe dans les pièces de Duinroos en regardant tout avec des yeux de vacancier. D’abord l’étage : la petite chambre bleue sous les toits. La chambre de Betty, c’est ainsi que je l’appelle. Betty et Herman Slaghek vont sans doute revenir cette année, trois semaines en mai, pour la cinquième fois. Puis je redescends l’escalier : mon voisin l’a repeint cet hiver. Je n’ai pas demandé l’autorisation à M. Duinroos ; de toute façon, il s’en remet à moi. Je lui ai envoyé la facture de la peinture ; quant à Bart, il n’a bien entendu pas demandé un centime pour la main-d'œuvre. Les marches avaient l’air moisies ; au fil des ans, la peinture blanche s’était écaillée, à croire que les gens n’ont rien de mieux à faire que passer leurs vacances à monter et descendre cet escalier.
Au rez-de-chaussée, depuis le temps que je viens ici, j’ai mon petit circuit. Pour commencer, la chambre d’enfant, près de la porte d’entrée, ensuite la cuisine, puis, en passant par le salon, la chambre des parents sur le côté de la maison. Je soulève de nouveau les rideaux pour voir s’il n’y a pas d’araignée morte par terre. Les W.-C., inutile de les inspecter une dernière fois car, nerveuse comme je suis, je les visite toutes les deux minutes comme si je m’apprêtais à partir en voyage.
Une fois que je suis passée partout, la partie d’échecs peut commencer. J’aurais pu être un Grand Maître. Où placer les fleurs ? Sur la table ronde ? Ou, malgré tout, sur la table basse, près des portes-fenêtres, afin qu’elles aient plus de lumière ? Les gaufres au miel que j’ai achetées pour les locataires, faut-il les mettre dans la boîte à gâteaux ou les laisser dans leur paquet sur le plan de travail ? Et le Livre d’or ? En guise de signet, je place à la page vierge qui marque le début de la nouvelle saison une feuille de hêtre plus que morte. Elle n’est plus que contours et nervures et, entre celles-ci, membrane transparente aussi résistante que du papier épais. Je l’ai repérée par hasard alors que je promenais le carlin de ma fille dans le bois, derrière le port. Un bois où pas un hêtre ne pousse. Pour que je la trouve là, il faut que le vent l’ait amenée de l’autre côté de l’île. Un dernier coup d'œil dans la cuisine en regardant par le passe-plat : allumettes à leur place près de la cuisinière, porte du frigo fermée, sucre, thé…
Terminé. Il est temps de partir… non, pas encore, encore un petit tour au premier. Mais pourquoi ? Je n’ai rien à y faire, je viens d’y aller. Tout est en ordre, et pourtant je ne peux m’empêcher de remonter. Gravir encore une fois l’escalier, prendre plaisir à voir briller les marches quand j’allume la lumière, regardez-moi ça… Qu’est-ce que c’est, là, au-dessus du portemanteau, sur l’étagère ? Une paire de gants ? Bizarre que je ne les aie pas remarqués plus tôt : des gants de femme, un modèle qu’on ne voit quasiment plus. Cuir marron côté paume et coton beige pour le dos fait au crochet : des gants de conduite, oui, c’est comme ça que ça s’appelle.
Il n’est pas rare que les gens oublient des choses, mais en général, je le remarque dès que je mets les pieds ici. Quand il n’y a pas de nom dessus, je les garde. Si aucun vacancier ne s’est manifesté dans les mois qui suivent, je leur cherche un nouveau propriétaire. Pour les parapluies, les cravates, les lunettes de soleil, il n’est guère difficile d’en trouver, et bien souvent, le nouveau propriétaire, c’est moi. Mais qu’est-ce que j’ai ? je crois bien que je me ratatine. Avant, je n’avais pas besoin de me mettre sur la pointe des pieds pour prendre un objet sur cette étagère.
Avec un peu de recul, je ne comprends pas ce qui m’a poussée à les essayer. Un seul coup d’oeil suffisait pour voir que, même s’ils sont très beaux, ils sont bien trop petits pour moi ; on ne peut pas dire que j’ai des mains fines. Pourtant, à l’instar de la demi-soeur de Cendrillon qui s’échine à introduire son pied disgracieux dans la petite pantoufle de vair, je me suis empressée d’essayer le gant droit. Avant même d’avoir enfoncé mes doigts, j’ai senti un truc : un bout de papier.
Une habitude qui ne m’est pas étrangère : il m’arrive à moi aussi de cacher une enveloppe prête à être postée ou un certificat de garantie plié en quatre dans un de mes gants, la différence étant que ce papier-là était bien plus épais. Je l’ai retiré, déplié et tout de suite reconnu : même papier blanc cassé que les pages du Livre d’or. Sept feuilles au total, pliées comme une lettre, et c’est en les dépliant que j’ai commencé à comprendre. Nul besoin de consulter le Livre d’or pour me souvenir qu’un grand nombre de pages avait disparu l’an passé. Déchirées, par la dernière locataire. Ça m’avait plutôt chiffonnée. Et ça me chiffonnait toujours. Qu’on puisse faire ça m’échappe. Une tache, des ratures, passe encore, mais déchirer autant de pages ! Savoir ce qu’on avait bien pu écrire dessus, ça n’avait cessé de me turlupiner, j’étais même retournée à Duinroos pour regarder dans la boîte du Scrabble si elles n’avaient pas servi à compter les points. C’est en remettant le couvercle sur la boîte que je me suis dit : mais avec qui aurait-elle pu jouer ? Pour autant que je sache, elle était toute seule. C’était fin septembre, la saison était quasiment terminée.
Ça ne m’a pas lâché de tout l’hiver. Qu’avait-on écrit qui, à la réflexion, ne pouvait être lu par des tiers, par quiconque ? Et c’est aussi ce que j’aurais dû me dire à l’instant, quand j’ai chaussé mes lunettes et ai déplissé les feuilles. Mais avant que je m’en sois rendu compte, je les avais déjà lues : Je suis venue sur l’île pour être seule quelques jours et, à présent que j’y suis, j’éprouve le besoin irrépressible de parler, et je marmotte toute seule bien plus souvent que je ne le fais à la maison. Est-ce à cause du silence, le silence d’une maison que je ne connais pas et d’où proviennent d’autres bruits que ceux auxquels je suis habituée ?
En relisant ces phrases sur le silence et ce que cela lui inspire, je hoche une nouvelle fois la tête. Je ressens la même chose qu’elle. Quand je suis ici, je me mets à parler toute seule. Comme s’il restait une trace de chacune des personnes ayant séjourné entre ces murs et que toutes participaient à une réception. Comme si je l’entendais parler, la femme en rouge. Je la vois devant moi – belle silhouette, cheveux très noirs, et sur le devant, une mèche blanche comme neige –, assise sur la terrasse, bondissant de sa chaise toutes les deux minutes et voletant. Ce qu’elle était maigre ! la peau sur les os. À présent, je sais pourquoi… peut-être n’est-il pas trop tard, peut-être n’y a-t-il pas encore de métastases et que je reviendrai l’an prochain…
Si je voulais, je pourrais demander à M. Duinroos une liste des locataires de l’an dernier ainsi que le nom de ceux qui ont réservé cette année. D’année en année, il conserve tous les noms. Mais même sans cette liste, je sais déjà qu’elle ne reviendra pas. Elle ne désirait rien tant que revoir l’île, nulle part elle n’était aussi heureuse qu’ici, mais elle ne l’ignorait pas elle-même : c’était son dernier séjour. Elle ne se plaint pas ; toutefois, je lis entre les lignes à quel point elle souffrait. Comment ne m’en suis-je pas rendu compte ? L’ai-je bien observée ? À chaque fois que je la saluais d’un geste de la main, elle me répondait par le même geste… attendait-elle plus de moi ?
Autant de questions qui me hantent, mais j’ai beau ouvrir les fenêtres pour faire un courant d’air, elles ne s’en vont pas. Si j’avais remarqué combien elle allait mal, j’aurais pu lui être, qui sait, d’un quelconque secours. Est-ce que j’en fais assez pour les locataires ? Dois-je prendre l’habitude de venir sonner deux ou trois jours après leur arrivée ? Leur demander comment ça va, s’ils ont compris comment marche le chauffe eau, s’ils ont assez de couvertures, si personne ne souffre d’une maladie grave ?
Je me suis toujours félicitée d’être à même de faire ce travail ; en laissant aux locataires une maison nickel au début de la saison, je contribue à leur bien-être. De nos jours, c’est à peine si les gens sont encore capables d’expliquer quel métier ils font, alors que de mon côté, les choses sont claires : quand c’est propre, c’est propre. Pour le reste, je veille au grain, je passe à l’occasion devant Duinroos à vélo, fais un signe de la tête, car on ne se sent chez soi qu’à partir du moment où quelqu’un vous salue. Au moins, je m’occupe un peu puisque mes enfants ont quitté la maison depuis des années.
Mais en ce moment, c’est la table que je regarde et je m’imagine cette femme, juste avant de quitter l’île, de bon matin, en train d’écrire comme une forcenée sous la lumière de la lampe, la noctuelle sur le revers de son gilet rouge. Elle affirme certes qu’il lui faut écrire, que c’est maintenant ou jamais, mais peut-être aurait-elle préféré avoir une oreille attentive. Quelqu’un pouvant lui répondre. Maintenant, c’est trop tard. Que faire de tous les souvenirs qu’elle avait de sa mère, de ses enfants, de son Edu ? Que faire de pensées que personne n’était censé connaître ? Ou tenait-elle malgré tout, sans se l’avouer, à ce que quelqu’un lise un jour ce qu’elle écrivait ? Comment, sinon, expliquer qu’elle ait oublié ses gants ? Où est-ce déjà… Personne ne lira jamais ces lignes et pourtant je tiens à les écrire.
Elle ne pouvait savoir que c’est moi qui les trouverais. Moi qui ai du mal à jeter les choses. Avec ce qu’il lui restait d’énergie, elle s’est épanchée sur le papier, et il faudrait que je brûle ça dans la cheminée ? C’est au-dessus de mes forces. J’aurais l’impression de jeter aux flammes quelque chose qui respire encore. Quand je me suis mariée, on nous a offert un carreau de Delft sur lequel figure un adage : « On entre dans le concert de la vie sans en avoir le programme », et ce que cette femme a écrit est tout aussi vrai : Au fond, l’homme n’a rien si ce n’est un nom, voilà ce qu’il m’a toujours été donné de comprendre, d’une façon ou d’une autre, et mieux que partout ailleurs, sur cette île. Parce qu’ici, rien n’est à moi non plus. Rien de ce qui me procure tant de plaisir ici, je ne peux le dire mien.
![]() , pour en savoir plus...
, pour en savoir plus... traduit de l'allemand par Johannes Honigmann
traduit de l'allemand par Johannes Honigmann 




 Un nouveau livre de Carlos Ruiz Zafón vient de sortir en août 2009, « Le jeu de l'Ange » et j'ai très envie de le découvrir !
Un nouveau livre de Carlos Ruiz Zafón vient de sortir en août 2009, « Le jeu de l'Ange » et j'ai très envie de le découvrir ! 

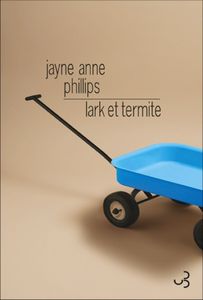 traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Amfrevile
traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Amfrevile

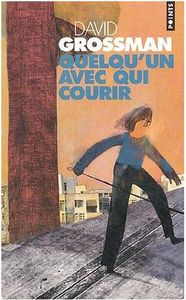
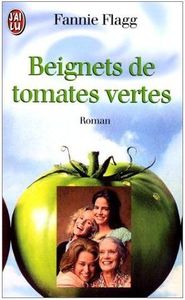







 Gallimard – octobre 2007 – 356 pages
Gallimard – octobre 2007 – 356 pages



/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)