Le cas Sneijder - Jean-Paul Dubois
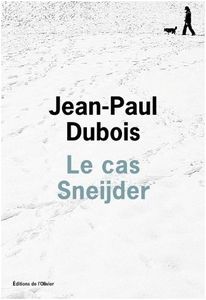 L'Olivier – octobre 2011 – 217 pages
L'Olivier – octobre 2011 – 217 pages
Quatrième de couverture :
« Je devrais être mort depuis le mardi 4 janvier 2011. Et pourtant je suis là, chez moi, dans cette maison qui m?est de plus en plus étrangère, assis, seul devant la fenêtre, repensant à une infinité de détails, réfléchissant à toutes ces petites choses méticuleusement assemblées par le hasard et qui, ce jour-là, ont concouru à ma survie. »
Victime d'un terrible - et rarissime - accident d'ascenseur dans une tour de Montréal, Paul Sneijder découvre, en sortant du coma, qu'il en est aussi l'unique rescapé. C'est le début d'une étrange retraite spirituelle qui va le conduire à remettre toute son existence en question. Sa femme, ses fils jumeaux, son travail, tout lui devient peu à peu indifférent. Jusqu'au jour où, à la recherche d'un emploi, il tombe sur la petite annonce qui va peut-être lui sauver la vie.
Ce roman plein de mélancolie est aussi une comédie étincelante. L'auteur d' Une vie française y affirme à nouveau avec éclat son goût pour l'humour noir.
Auteur : Jean-Paul Dubois est né en 1950 à Toulouse où il vit actuellement. Journaliste, puis grand reporter en 1984 pour Le Nouvel Observateur, il examine au scalpel les États-Unis et livre des chroniques qui seront publiées en deux volumes aux Éditions de l'Olivier : L'Amérique m'inquiète (1996) et Jusque-là tout allait bien en Amérique (2002).Écrivain, Jean-Paul Dubois a publié de nombreux romans, Je pense à autre chose, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, etc. Il a obtenu le prix France Télévisions pour Kennedy et moi (Le Seuil, 1996) et le prix Femina et le prix du roman Fnac pour Une Vie française.
Mon avis : (lu en décembre 2011)
J'ai pris ce livre à la Bibliothèque sans a priori, mes lectures précédentes de cet auteur avaient été mitigées, j'avais beaucoup aimé Une vie française mais j'avais déçu par Les accommodements raisonnables.
Cela commence par un accident tragique d'ascenseur, Paul aurait du y rester mais il est miraculeusement le seul survivant. Dans l'accident, il perd sa fille Marie qui l'accompagnait.
Il se met à détester sa vie passée, il abandonne son travail de négociant en vins. Et il supporte de moins en moins sa femme Anna, qui a toujours refusé la présence de Marie (fille d'un premier mariage) dans sa vie et celle de ses fils jumeaux. Il se met à faire des recherches documentaires sur les ascenseurs, et pour échapper à des angoisses lorsqu'il se trouve entre des murs, il prend un travail en pein air et devient Dogwalker (promeneur de chiens)...
Le personnage de Paul est attachant et émouvant dans sa mélancolie, sa solitude au contraire Anna et ses jumeaux deviennent de plus en plus cyniques le livre avançant.
C'est un livre qui mélange des passages graves et d'autres d'humour noir et décalé, on y rencontre des personnages hauts en couleurs. C'est très bien écrit, très prenant, très sombre mais aussi tragiquement drôle. A découvrir !
Extrait : (début du livre)
Je me souviens de tout ce que j’ai fait, dit ou entendu. Des êtres et des choses, de l’essentiel comme du détail, fût-il mièvre, insignifiant ou superfétatoire. Je garde, je stocke, j’accumule, sans discernement ni hiérarchie, m’encombrant d’un accablant fardeau qui en permanence travaille mon âme et mes os. Je voudrais parfois libérer mon esprit et me déprendre de ma mémoire. Trancher dans le passé avec un hachoir de boucher. Mais cela m’est impossible. Je ne souffre ni d’hypermnésie ni d’un de ces troubles modernes du comportement solubles dans le Bromazepam. Je crois savoir ce qui ne fonctionne pas chez moi. Je n’oublie rien. Je suis privé de cette capacité d’effacement qui nous permet de nous alléger du poids de notre passé. En le retaillant saison après saison, en lui donnant une forme acceptable, nous nous efforçons de le cantonner dans des domaines raisonnables. C’est la seule façon de lutter contre cette fonction d’enregistrement envahissante et destructrice. Mais quelle que soit l’ampleur de nos coupes, année après année, tel un lierre têtu et dévorant, lentement, notre mémoire nous tue.
Je devrais être mort depuis le mardi 4 janvier 2011. Et pourtant je suis là, chez moi, dans cette maison qui m’est de plus en plus étrangère, assis, seul devant la fenêtre, repensant à une infinité de détails, réfléchissant à toutes ces petites choses méticuleusement assemblées par le hasard et qui, ce jour-là, ont concouru à ma survie. Nous étions cinq dans la cabine. Je suis le seul survivant.
L’accident s’est produit à 13 h 12 précises. Le mécanisme de ma montre s’est bloqué sous l’effet du choc. Depuis ma sortie de l’hôpital je la porte à mon poignet droit. Elle m’accompagne partout, silencieuse, l’oscillateur mécanique à l’arrêt, le balancier et la trotteuse figés, me rappelant, parfois, lorsque la manche de ma chemise découvre le cadran, l’heure qu’il est vraiment et qu’il sera sans doute à chaque minute, jusqu’à la fin de ma vie.
Avant de parler de ce 4 janvier, il me faut revenir sur un événement qui s’est produit le 3 au soir et qui, depuis, ne cesse de m’accompagner comme une ombre qui ne serait pas la mienne.
J’étais dans la cuisine, je préparais des pâtes au pesto en regardant la neige recouvrir le jardin et former une accumulation cotonneuse sur le rebord de la fenêtre. La télévision donnait des nouvelles qui se diluaient dans l’air chargé des effluves de basilic. Mon attention fut attirée par les images d’un curieux reportage. On y voyait des hommes vêtus de combinaisons blanches, portant des gants de protection, et le visage recouvert d’un masque à gaz, ramasser d’innombrables oiseaux morts dans les rues et sur les toits des maisons d’un petit village. Ces fossoyeurs aviaires saisissaient délicatement les cadavres avec une pince ou du bout des doigts, comme s’ils manipulaient une matière dangereuse, et les glissaient dans des sacs en plastique noirs. La scène se déroulait à Beebe en Arkansas, bourgade peuplée de cinq mille six cents habitants. En tout, on retrouva un peu plus de cinq mille oiseaux écrasés sur le sol. Presque un par habitant. L’hécatombe s’était produite durant la nuit. Les gens avaient entendu des bruits et surtout de violents impacts sur leurs toits. Comme si quelqu’un, dehors, jetait des pierres sur les bardeaux. Certains étaient sortis sur le seuil de leur porte et avaient vu alors tous ces oiseaux tombés du ciel : des carouges à épaulettes.
Déjà lu du même auteur :


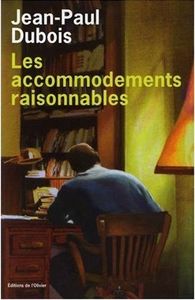

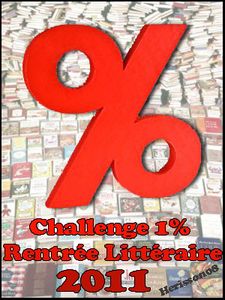
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F69%2F536764%2F117390076_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F94%2F536764%2F117922332_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F10%2F536764%2F117306518_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F52%2F90%2F536764%2F117763556_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)