 Éditions de l'Olivier - août 2009 – 296 pages
Éditions de l'Olivier - août 2009 – 296 pages
traduit de l'anglais (États-Unis) Anne Wicke
Quatrième de couverture :
Hans et Rachel vivent à New York avec leur jeune fils lorsque surviennent les attentats du 11-Septembre. Quelques jours plus tard, ils se séparent, et Hans se retrouve seul, perdu dans
Manhattan, où il ne se sent plus chez lui. Il fait la connaissance de Chuck, un homme d’affaires survolté qui rêve de lancer le cricket à New York. Sur des terrains de fortune, Hans tente d’échapper à la mélancolie. Le charisme de Chuck draine une foule de joueurs du dimanche, tous venus d’ailleurs – de Trinidad, de Guyane ou de plus loin encore –, tous persuadés que l’Amérique reste le pays des possibles.
Alors que le monde entier ne croit plus en rien, eux continuent d’espérer. Au milieu de ces exilés, Hans retrouve un second souffle. Mais qui est Chuck ? Il faudra des années avant que le mystère qui entoure sa véritable identité finisse par se dissiper.
Ce très beau livre, souvent comparé à Gatsby le Magnifique, est à la fois une parabole sur la fin du rêve américain et un roman d’amour aux résonances poignantes.
Auteur : Né à Cork (Irlande) en 1964, irlandais par son père, Turc et francophone par sa mère, Joseph O'Neil grandit au Mozambique, en Iran et au Pays-Bas avant de devenir avocat d'affaires à Londres puis de s'installer à New York avec son épouse britannique... Cet héritage culturel pour le moins hétéroclite nourrit l'intrigue et l'univers de son troisième roman et premier succès, 'Netherland', un portrait du New York de l'après-11-septembre paru en 2009 en France. Journaliste pour Atlantic Monthly, Joseph O'Neil est également l'auteur de 'Blood-Dark Track : a Family History', une enquête autobiographique sur le passé de ses grands-parents.
Mon avis : (lu en avril 2010)
Pourquoi ai-je choisi ce livre à la bibliothèque ? En premier lieu parce que l'auteur est né en Irlande (suite au swap St Patrick, je suis toujours curieuse de découvrir des auteurs irlandais), ensuite la lecture de la quatrième de couverture m'a donné envie... enfin, les Éditions de l'Olivier sont souvent pour moi gage de qualité.
Le titre est mystérieux, « Netherland », un dictionnaire m'apprend que cela veut dire « Pays-Bas », nom du pays d'origine du narrateur, Hans (dont le nom intégral est Johannus Franciscus Hendrikus van den Broek).
Hans a la trentaine, il est analyste financier. Il est né et à grandit aux Pays-Bas, à l'âge de 20 ans il est parti travailler à Londres, il a rencontré Rachel et s'est marié avec elle. En 1999, Hans et Rachel sont partis s'installer à New-York, ils ont eu un fils Jack. L'essentiel de l'action du roman se situe quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001 : la chute des tours a ébranlé leur couple « Nous avions perdu la capacité de nous parler. L’attaque contre New York avait ôté tout doute à ce sujet. Elle ne s’était jamais sentie aussi seule, aussi mal, aussi loin de chez elle, que durant ses dernières semaines… » Rachel est retourné à Londres avec Jack et Hans vit maintenant seul dans New-York encore traumatisée, il retourne environ deux fois par mois à Londres pour voir son fils. Il va faire par hasard la rencontre de Chuck, originaire de Trinidad, autour d'une passion commune le cricket. L'auteur utilise le criquet comme un symbole de justice et de fraternité entre les hommes et nous offre le portrait d'un New-York multiculturel car en effet, l’équipe de Hans est composé d’hommes originaires de Trinidad, de Guyane, de Jamaïque, d’Inde, du Pakistan et du Skri Lanka, soit trois hindouistes, trois chrétiens, un sikh, quatre musulmans…
En découvrant ce livre, j'ai appris également que Netherland, un an après sa sortie aux États-Unis, avait bénéficié d’une publicité exceptionnelle, en effet, interrogé sur ses lectures par la BBC, Barack Obama avait répondu qu’il était en train de le lire, et qu’il le trouvait « excellent ».
Pour ma part, je ne suis pas aussi enthousiaste concernant ce livre, j'ai bien aimé ce portrait multicolore de New-York, mais le criquet est resté pour moi un sport mystérieux...
Extrait : (début du livre)
La veille de mon départ de Londres pour New York - Rachel m'avait précédé de six semaines -, dans l'après-midi, je me trouvais au travail, à mon bureau, je rassemblais mes affaires, lorsqu'un des grands vice-présidents de la banque, un Anglais d'une cinquantaine d'années, vint me souhaiter bonne chance. J'en fus surpris ; il travaillait dans une autre partie de l'immeuble, dans un autre service, et nous ne nous connaissions que de vue. Néanmoins, il me demanda force détails sur l'endroit où je comptais m'installer (« Watts Street ? À quelle hauteur, dans Watts ? »), puis s'épancha quelques minutes sur les souvenirs de son loft dans Wooster Street et de ses virées au magasin « original » Dean & DeLuca. Il ne cherchait
absolument pas à dissimuler son envie.
« Nous n'y resterons pas longtemps », dis-je en la jouant profil bas sur ma bonne fortune.
Car tel était le plan conçu par ma femme : s'installer à New York un à trois ans puis rentrer.
« Vous pensez ça aujourd'hui, me dit-il. Mais New York, c'est une ville qu'il est très difficile de quitter. Et une fois qu'on la quitte... »
Il ajouta en souriant : « Elle me manque toujours, pourtant, j'en suis parti il y a douze ans. »
Ce fut alors mon tour de sourire - un peu parce que j'étais gêné, en fait, car il avait parlé avec une spontanéité tout américaine.
« Eh bien, nous verrons, dis-je.
- Oui, c'est ça. Vous verrez. »
Son assurance m'agaça, bien qu'il me fît avant tout pitié - comme l'un de ces habitants du Saint-Pétersbourg de jadis, rejeté du mauvais côté de l'Oural par ses fonctions. Mais il s'avère qu'il avait raison, d'une certaine manière. Maintenant que, moi aussi, j'ai quitté cette ville, j'ai bien du mal à me débarrasser de l'impression que la vie a un goût de fenaison et de regain. Ce dernier mot, m'a un jour dit quelqu'un, renvoie dans un premier sens à l'herbe qui repousse dans un champ déjà fauché. Vous pourriez dire, si vous êtes le genre de personne encline aux observations d'ordre général, que New York met l'accent sur la fenaison répétitive effectuée par la mémoire - sur cette sorte d'autopsie déterminée qui a pour effet, on nous le dit et on l'espère sans trop y croire, de faucher le passé herbeux en de maîtrisables proportions. Car il ne cesse de repousser, bien sûr. Rien de tout cela ne signifie que je souhaiterais m'y trouver à nouveau en ce moment ; naturellement, j'aimerais penser que ma propre rétrospection est d'une certaine façon plus importante que celle de ce vieux vice-président. Lorsque j'en fus gratifié, elle ne me parut pas être grand-chose de plus qu'une nostalgie ordinaire. Mais, dans le fond, cela n'existe pas, la nostalgie ordinaire, suis-je tenté de conclure ces temps-ci, pas même si vous sanglotez sur un ongle cassé. Qui sait ce qui est arrivé à ce type, là-bas ? Qui sait ce qui se cache derrière son histoire d'aller acheter du vinaigre balsamique ?
Il en parlait comme d'un élixir, le pauvre crétin.
En tout cas, pendant les deux premières années qui ont suivi mon retour en Angleterre, je fis de mon mieux pour ne pas regarder du côté de New York - où, après tout, j'avais été malheureux pour la première fois de ma vie. Je n'y retournai pas, j'évitai de me demander trop souvent ce qu'il était advenu d'un homme appelé Chuck Ramkissoon, qui avait été mon ami durant mon dernier été passé sur la côte Est et qui était devenu depuis, comme cela arrive fréquemment, une silhouette éphémère. Et puis, un soir, au printemps de cette année 2006, Rachel et moi nous nous trouvons à la maison, à Highbury. Elle est plongée dans un article de journal. Je l'ai déjà lu. Cela parle de la découverte en Colombie d'un groupe tribal de la forêt amazonienne. On dit qu'ils en ont assez de leur vie difficile dans la jungle, même si l'article précise qu'ils n'aiment rien tant que manger du singe, grillé puis bouilli. Une photographie troublante d'un garçon rongeant un petit crâne noirci illustre le propos. La tribu n'a aucune idée de l'existence du pays dans lequel ils se trouvent, la Colombie, aucune idée non plus, et c'est plus dangereux, de l'existence de maladies comme le simple rhume, ou la grippe, contre lesquelles ils n'ont pas de défenses naturelles.
« Coucou, dit Rachel, hé, t'as vu, on parle de ta tribu. »
J'ai encore le sourire aux lèvres lorsque je réponds au téléphone qui sonne. Une journaliste du New York Times demande monsieur van den Broek.
« C'est au sujet de Kham, euh, Khamraj Ramkissoon... précise la journaliste.
- Chuck, dis-je en m'asseyant à la table de la cuisine. C'est Chuck Ramkissoon. »
Elle me dit que les « restes » de Chuck ont été retrouvés dans le Gowanus Canal. Ses poignets étaient menottés et, de toute évidence, il avait été victime d'un meurtre. Je garde le silence. J'ai l'impression que cette femme vient de proférer un mensonge éhonté et que si j'y réfléchis suffisamment une réfutation va me venir.
« Vous le connaissiez bien ? dit sa voix, avant d'ajouter, comme je ne réponds pas : il est écrit quelque part que vous étiez son associé.
- C'est inexact.
- Mais vous travailliez bien ensemble, non ? C'est ce que dit ma note.
- Non. Vous avez été mal informée. C'était juste un ami.
- D'accord, d'accord. »
On entend qu'elle tape sur son clavier, puis, une pause.
« Bon, alors, vous pouvez me dire quelque chose sur son... milieu ?
- Son milieu ? dis-je, suffisamment surpris pour corriger sa prononciation légèrement meuglante du mot.
- Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, avec qui il traînait, les ennuis dans lesquels il aurait pu se mettre, s'il connaissait des personnages un peu louches... C'est assez inhabituel, ce qui lui est arrivé », ajoute-t-elle avec un petit rire.
Je me rends compte que je suis bouleversé, et même, furieux.
« Oui, je finis par dire. Vous avez une bonne histoire sous le
coude, là. »
Le lendemain, il y a un petit article dans la section « Nouvelles locales ». Il a été établi que le corps de Chuck Ramkissoon gisait depuis plus de deux ans dans l'eau, près de l'entrepôt du Home Depot, parmi les crabes, les pneus de voitures et les caddies de supermarché, jusqu'au jour où un de ces plongeurs en zone urbaine fit une « découverte macabre » alors qu'il filmait un banc de bars rayés. Dans la semaine qui suit paraissent sur le sujet quelques petites choses au compte-gouttes, mais aucune information véritable. Cela semble cependant intéresser les lecteurs et rassurer certains traditionalistes de savoir que le Gowanus Canal peut toujours rejeter la victime d'un meurtre. Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir, comme l'a dit un commentateur plein d'esprit.
« Alors, qui est cet homme ? » me demande Rachel, allongée dans le lit à côté de moi, le soir où nous avons appris la nouvelle.
Comme je ne réponds pas immédiatement, elle pose son livre.
« Oh, je suis sûr que je t'en ai déjà parlé. Un joueur de cricket que je connaissais. Un type de Brooklyn.
- Chuck Ramkissoon ? » répète-t-elle.
Sa voix a un ton détaché qui ne me plaît pas. Je me tourne sur une épaule et ferme les yeux.
« Oui, dis-je. Chuck Ramkissoon. »
Chuck et moi, nous nous étions rencontrés pour la première fois en août 2002. Je jouais au cricket dans le Randolph Walker Park, à Staten Island, et Chuck se trouvait là. Il était l'un des deux arbitres indépendants qui proposaient leurs services en échange d'honoraires de cinquante dollars. Le jour était épais comme de la gélatine, avec une atmosphère chaude et vitreuse, sans aucun vent, pas même la brise venant du Kill van Kull qui coule à moins de deux cents mètres de Walker Park, séparant Staten Island du New Jersey. D'assez loin, au sud, montait le grondement sourd du tonnerre. C'était bien là le genre d'après-midi américain à la viscosité barbare qui me faisait vivement regretter les ombres projetées par les mouvements rapides des nuages d'été dans le nord de l'Europe, regretter même ces jours où vous jouiez au cricket en portant deux pull-overs, sous un ciel froid parsemé çà et là d'un pan de bleu - assez grand pour tailler une culotte de gendarme, comme disait ma mère. Selon mes propres critères, Walker Park était un endroit fort médiocre pour jouer au cricket. L'aire de jeu était, je suis sûr que c'est toujours le cas, deux fois plus petite que la taille réglementaire d'un terrain de cricket. Le terrain proprement dit est inégal et l'herbe y est toujours trop haute, même lorsqu'elle est tondue (un jour, en cherchant une balle, j'ai failli tomber sur un canard caché dans l'herbe, ce qui, pour les joueurs, est de très mauvais augure 1) ; et, alors que le vrai cricket, comme certains pourraient le nommer, se joue sur une livrée en pelouse, celle de Walker Park est en terre battue, et non en gazon, et doit être recouverte d'un tapis en fibres de coco ; par ailleurs, la terre en question est de la terre battue de base-ball, pâle et sableuse, elle n'est pas rouge comme celle des terrains de cricket : on ne peut alors compter bien longtemps sur la fiabilité du rebond. Et quand bien même on pourrait parler de fiabilité du rebond, il manquera toujours de variété et de complexité. (En revanche, les livrées faites de vraie terre et d'herbe sont riches de possibilités : elles seules peuvent pleinement mettre au défi et récompenser le répertoire du lanceur, avec ses balles lentes, tournantes, courtes à rebond, ou déviées, et seules ces balles peuvent mettre en action et véritablement à l'épreuve le répertoire du batteur, ses coups défensifs et offensifs, sans parler de son mental.) Il y a un autre problème. De grands arbres - des chênes des marais, des chênes rouges, des gommiers,
des tilleuls américains - longent de manière désordonnée les bordures de Walker Park. Il faut considérer que chaque élément de ces arbres, même la plus petite feuille qui pend, fait partie des limites du terrain, ce qui confère une dimension aléatoire au jeu.
Souvent, il arrive qu'une balle roule entre les troncs. Le joueur de l'équipe au champ qui doit courir après la balle va alors disparaître partiellement, et lorsqu'il réapparaît, la balle à la main, un concours de cris démarre, exigeant de savoir comment les choses se sont exactement passées.
 Flammarion – mars 2010 – 150 pages
Flammarion – mars 2010 – 150 pages Les grand-mères (2005) et
Les grand-mères (2005) et  Un enfant de l'amour (2007)
Un enfant de l'amour (2007)





 Éditions de l'Olivier - août 2009 – 296 pages
Éditions de l'Olivier - août 2009 – 296 pages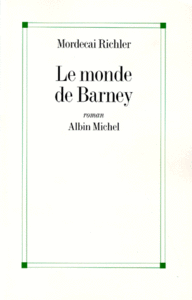
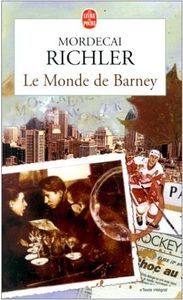




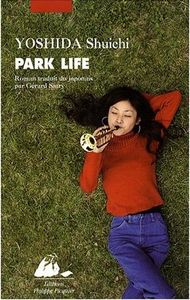
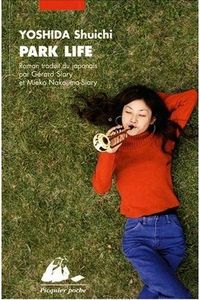
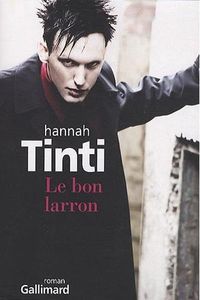 Gallimard – novembre 2009 – 375 pages
Gallimard – novembre 2009 – 375 pages 

 Balland – janvier 2010 – 379 pages
Balland – janvier 2010 – 379 pages


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)