Les disparues de Vancouver – Élise Fontenaille
 Grasset – février 2010 – 194 pages
Grasset – février 2010 – 194 pages
Présentation de l'éditeur :
" Pourquoi sortir l'affaire des disparues de Vancouver au moment des Jeux olympiques ? Parce qu'elle en est le négatif absolu... D'un côté, les cimes, la blancheur, la glace, l'exploit, la vitesse, les corps vainqueurs, venus du monde entier, ce que Vancouver veut montrer au monde, une image rêvée... De l'autre, la noirceur, un gouffre au coeur de la ville, les corps vaincus, détruits, drogués, les Indiennes, l'échec, la mort, tout ce que l'on voudrait cacher. " A Vancouver, les prostituées du downtown eastside disparaissent. Soixante-neuf déjà. Parmi elles, Sarah, jolie, rieuse, pleine de vie. Mais qui se soucie du sort de ces filles qui vendent leur corps pour un peu d'héroïne ? Dans ce roman vrai, émouvant, lucide, Elise Fontenaille offre à Sarah un espoir de survie : tombeau et résurrection.
Auteur : Elise Fontenaille, romancière, née à Nancy en 1960, elle a été journaliste pendant quelques années. Elle est l'auteur de La gommeuse (1997), Le Palais de la femme (1999), Demain les filles on va tuer papa (2001), L'enfant rouge (2002), Brûlements (2006), L'aérostat (2008). Fabuleuse raconteuse d'histoire, elle aime explorer des univers singuliers et mettre en scène des personnages atypiques.
Mon avis : (lu en avril 2010)
J'ai entendu parler de ce livre lors d'une émission de radio «Café crime» de Jacques Pradel sur Europe 1. Ce roman appartient à la collection « Ceci n'est pas un fait divers » et s'est inspiré d'un horrible fait divers. A Vancouver, durant plusieurs années, soixante-neuf prostituées du downtown eastside disparaissent sans explication. Le 5 février 2002, le coupable sera arrêté et la vérité atroce sur ses disparitions sera connue de tous. « Le procès Pickton durera six mois, de mai à décembre 2007 »
A travers ce récit l'auteur nous montre le combat difficile des proches des disparues pour tenter de les retrouver et de comprendre, elle dénonce aussi l'absence totale d'action de la part de police et des autorités considérant que les disparitions de pauvres indiennes, droguées et prostituées ne nécessitent pas d'enquête. Nous découvrons également la vie difficile des femmes de ce quartier downtown eastside et plus largement celle de la communauté indienne qui est méprisée et laissée pour compte.
Downtown Eastside (DTES) est le quartier le plus pauvre du Canada, il est situé en plein centre de Vancouver, « dix blocs qui ressemblent à l'enfer » et affichent des taux très élevés de toxicomanie et de séropositivité. C'est une réalité que les autorités préfèrent ignorer. Les disparues sont des prostituées du DTES, elles font cela pour « se payer des doses de crack et d'héroïne ». Elles sont pour la plupart indiennes, putes et drogués, leurs disparitions n'inquiètent pas la police, c'est la juste conséquence de la vie qu'elles mènent ! L'auteur va nous raconter l'histoire de l'une des disparues, Sarah. « Métisse de Black et d'Indienne, adoptée tout bébé par une famille libéral », « Une enfance heureuse, en apparence... En proie au racisme et au rejet à l'école, mais ça, à la maison, personne ne le savait, elle n'en parlait jamais. Trop fière pour ça Sarah, trop blessée. », « A l'adolescence, tout à volé en éclats : fugue, drogue, prostitution... » Lorsque Sarah à disparue, son ami, Wayne Leng, tente de retrouver son corps pour lui offrir de dignes funérailles : il monte un site et réunit les proches des autres disparues pour alerter les médias et l'opinion publique.
Avec ce livre, Élise Fontenaille dénonce également le racisme des canadiens vis à vis des populations indiennes. A travers un des chapitres du livre, elle revient sur un épisode tragique de l'histoire canadienne : depuis les années 1860 et jusqu'en 1970, les autorités canadiennes ont mis en place des orphelinats (les residential schools), « qui ressemblaient plutôt à des camps de concentration pour enfants », ils étaient destinés à assimiler les jeunes Indiens arrachés à leur tribu. L'auteur évoque aussi un livre de photos réalisées par Lincoln Clarkes, fasciné par les filles du Downtown Eastside, il les a traité « comme si elles devaient faire la Une de Vogue, comme si chacune était Sharon Stone ».

(la photo de la couverture est l'une des photos réalisées par Lincoln Clarkes)
Une histoire vraie qui nous donne de Vancouver une autre image que celle montrée lors des JO d'hiver. Le livre est court et percutant, il m'a donné envie d'en savoir plus.
Extrait :
Crab Park, la cérémonie
En ce matin de mai, il pleut à Vancouver, le port est embrumé. On devine la silhouette d'un cargo au loin, de hautes grues rouges qui oscillent en grinçant ; la cime des monts, de l'autre côté de la baie, a disparu, gommée par les nuages gris.
Le ciel est bas et lourd, comme souvent ici, mais cela n'altère en rien la splendeur du paysage : le spleen sied à Vancouver. Ciel liquide, océan, forêt, cité… Tout se confond, tout est noyé.
Une foule silencieuse est massée sous des parapluies colorés, face à l'océan Pacifique, devant un banc portant une plaque de cuivre gravé, dont la bruine ne parvient pas à ternir l'éclat.
Sur cette plaque, onze noms de femmes.
IN MEMORY OF L. COOMBES, S. DE VRIES,
M. FREY, J. HENRY, H. HALLMARK,
A. JARDINE, C. KNIGHT, K. KOSKI,
S. LANE, J. MURDOCK, S. SPENCE
& ALL OTHER WOMEN
WHO ARE MISSING. WITH OUR LOVE.
MAY 12, 1999.
Crab Park : une simple bande de gazon donnant sur le port industriel. Ici viennent les marins, les dockers… et aussi les filles de Skid Row, quand elles veulent se laver l'âme entre deux passes, en regardant l'océan, oublier un instant le downtown eastside, l'œil errant sur le gris ondoyant des vagues… Le Pacifique lave de tout, même des souillures de Skid Row.
Rassemblées en demi-cercle autour du banc, une centaine de femmes, la plupart indiennes, serrées les unes contre les autres, à deux ou trois sous un même parapluie, quelques hommes aussi. Soudain, les femmes se redressent, entonnent un chant rauque et lent, les hommes les accompagnent au tambour, battement sourd… Sans même comprendre, on a la gorge nouée. Une langue oubliée, surgie d'un passé obscur, qu'on croyait aboli… Même celles qui chantent, le sens des mots leur échappe, les jeunes surtout. Ce sont les anciennes qui mènent, elles savent, elles se souviennent… Il est question d'un départ, d'un chagrin qui n'a pas de fin.
A Vancouver, si l'on meurt, et si l'on a les moyens - cela coûte tout de même vingt mille dollars - on peut laisser un banc à son nom, dans un des parcs qui entourent la ville, avec quelques mots gravés, invitant les passants à se reposer un moment, à contempler l'océan… Un mémorial bucolique et léger.
Les femmes dont les noms sont inscrits ici ne sont pas mortes, pas officiellement en tout cas. Elles ont juste disparu.
Elles étaient là, au coin d'une rue… Soudain, elles n'y sont plus, nul n'a rien vu, rien entendu.
La mélopée s'interrompt, une femme s'empare d'un bâton hérissé de plumes d'aigle, le talking stick, elle prend la parole… Une Blanche robuste, Pat de Vries, la mère de Sarah, épaulée par Maggie, sa fille aînée.
S. DE VRIES : le deuxième nom sur le banc.
- Ce matin, je veux vous parler de Sarah, vous dire quelle enfant rieuse elle était, drôle, gaie, pleine d'énergie et de talents : elle dessinait, chantait, écrivait des poèmes aussi…
Les Indiennes opinent en silence, bras croisés, regards acérés ; des femmes fortes, elles en ont vu.
- … toujours à nous jouer des tours, tu nous faisais mourir de rire… Sarah, on ne rit plus aujourd'hui. Où es-tu ? Où êtes-vous toutes ?
Pat s'essuie les yeux. Un homme s'avance, prend le bâton à son tour : Wayne Leng, un ami de Sarah. La quarantaine gracile, un visage juvénile, barré d'une fine moustache à la Errol Flynn.
- Avant de disparaître, Sarah a laissé son Journal chez moi. Ceci, elle l'a écrit un soir de Noël, elle était seule dans les rues, elle avait froid… J'étais loin à ce moment-là.
Il lit, sa voix tremble un peu.
- Et voilà, une fois de plus c'est Noël. Cette année j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas d'arbre, pas de décoration, pas de dinde farcie pour le dîner. Le blues s'amplifie à chacun de mes souffles, le vide en moi grandit, il prend toute la place… Je sais que je n'en ai plus pour longtemps, je sais que bientôt, je vais disparaître. Ce soir je le ressens plus fort que jamais, déjà, je ne suis plus qu'une ombre… Est-ce qu'ils se souviendront seulement de moi, quand je ne serai plus là, les autres, leur vie continuera-t-elle comme avant ? Leurs yeux verseront-ils des larmes, le jour où ils me diront adieu…
Wayne plie la feuille en deux, la glisse dans sa poche, ému.
- On se souvient tous de toi, Sarah, on ne t'oubliera jamais… Je pense à toi très fort chaque jour et chaque nuit, tu seras toujours en moi.
Sarah, ça fait deux ans que Wayne la cherche, avec acharnement… Il a même quitté son travail, pour lui consacrer tout son temps.
C'est en déposant des affiches dans le downtown eastside, avec la photo de Sarah, qu'il a découvert qu'il y en avait bien d'autres, des disparues… Des affiches, il en a vu partout, sur les murs de Skid Row, laissées par des proches : des dizaines de femmes rayées de la carte du jour au lendemain, certaines depuis des années.
Quand il a vu les photos, il a compris que quelque chose de grave leur était arrivé, à toutes ces femmes… Il a essayé d'alerter les autorités, les flics lui ont ri au nez.
Un micheton, s'inquiéter pour une pute ? On aura tout vu…
Pour pallier le laxisme de la police, Wayne a créé un site, MISSING… C'est devenu sa vie, il y travaille jour et nuit.
Les enfants de Sarah sont là eux aussi, devant le banc, tout petits, blottis entre Pat et Maggie ; Pat pense que c'est bien qu'ils sachent, qu'ils soient présents, en ce jour. Ce qu'on leur cache, ils le devinent, alors…
- Pourquoi elle a pas de tombe, maman…, chuchote Sarah-Jean, petite fille aux grands yeux noirs, vivant portrait de Sarah.
Wayne se penche, caresse la petite tête brune… Il soupire, se relève, passe le bâton à la mère d'Angela Jardine.


 Flammarion – mars 2010 – 150 pages
Flammarion – mars 2010 – 150 pages Les grand-mères (2005) et
Les grand-mères (2005) et  Un enfant de l'amour (2007)
Un enfant de l'amour (2007)



 Éditions de l'Olivier - août 2009 – 296 pages
Éditions de l'Olivier - août 2009 – 296 pages

 Sonatine – février 2010 – 482 pages
Sonatine – février 2010 – 482 pages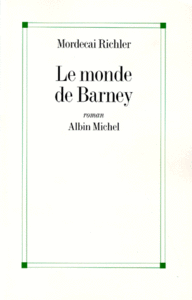
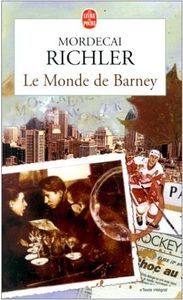

 Éditions Gallmeister – janvier 2010 – 220 pages
Éditions Gallmeister – janvier 2010 – 220 pages

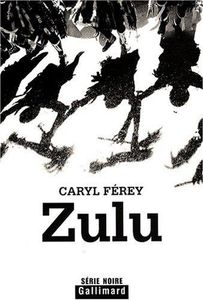

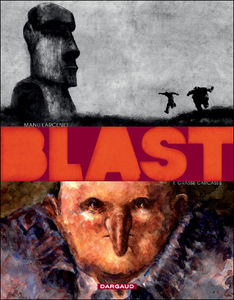 Dargaud – novembre 2009 – 204 pages
Dargaud – novembre 2009 – 204 pages



/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)